
En 1924, Carmen fuit le confort bourgeois de sa famille et un mariage arrangé. Elle se fait passer pour un garçon pour embarquer sur un bateau de pêche, en mer du Nord. En 1933, elle se donne à corps perdu dans la danse et va achever sa formation à la danse sacrée dans l’île de Java. En 1943, elle s’engage dans la Résistance. En 1975, proche de la mort, elle jette un regard lucide sur sa vie. Quatre moments de la vie d’une femme en quête de liberté mais à chaque fois rattrapée par le pouvoir des mâles, auxquels, par son testament, elle adresse un ultime défi.
Ce qui séduit avant tout dans ce roman militant, c’est la somptuosité de la langue, l’amour du mot précis, des images fortes, le rythme assuré de la phrase. À chaque page, des formules denses nous atteignent à vif : « assiégée d’inconnu », « elle les regarde se ressembler », « leurs entailles dans la nuit », « le silence pour commentaire »… Une sûreté d’écriture rare dans un premier roman. Bien sûr, on peut par moments regretter une touche de préciosité dans le mélange d’abstrait et de concret (« elle lui trouve une bouche de courage », « un inconfort léger habite la pièce »…), ou une répétition de procédé qui en affaiblit l’effet (« paré d’inconnu » n’a plus la même force que « assiégée d’inconnu »). Mais ces regrets sont rares — et très subjectifs. Ce livre annonce assurément une grande carrière de romancière.
Un des points forts de ce récit est la manière dont il se concentre sur la réaction, l’atmosphère, la sensation et non sur l’événement en lui-même, qui arrive tardivement dans le fil narratif et que le lecteur est prié de comprendre par des sous-entendus, quelques lignes subreptices, voire une allusion plus ou moins claire. Un exemple caractéristique est le passage où Carmen comprend que sa meilleure amie lui a volé son fiancé. L’annonce semble claire, pourtant : « Elle l’avait appris bêtement. » Mais durant deux pages, nous ne savons pas de quoi il s’agit. Puis une simple question pour nous mettre sur la piste : « On ne pouvait être à la fois la lame et le pansement, n’est-ce pas ? » Il faut être sacrément sûre de soi pour jouer ainsi avec son lecteur.
La priorité donnée au corps fait partie du projet romanesque. Le corps malmené, blessé, amputé, violenté, effacé. Le corps des femmes, bien entendu. « Ça lui rappelle à quel point leurs corps sont méprisables, aux yeux des lois, peu importe le côté de la frontière ou de l’hémisphère. » Il est cependant dommage que ce corps soit tellement intellectualisé, presque désincarné, malgré la violence de ce qu’il subit. On a l’impression de comprendre cette violence, non de la ressentir. Et si le côté militant est évidemment primordial dans ce regard d’une femme sur une autre femme, sa systématisation relègue à l’arrière-plan d’autres thèmes qui avaient leur importance — la puissance des rêves d’enfant, les rapports au père, la volonté de sortir du moule, de « s’en aller », ce qui donne quand même son titre au roman. Une fois, d’ailleurs, que l’on a intégré cet aspect militant, la surenchère n’y apporte plus grand-chose. Aux expériences traumatisantes vécues par Carmen, il manquait le viol : il est évoqué de justesse par un article de journal. Les épigraphes sont toutes empruntées à des autrices : en ont-elles plus de force ? Ce côté systématique finit par affaiblir ce qui est en fin de compte la vraie trouvaille du roman, le testament de Carmen et les réflexions qu’il éveille en nous. Un roman à lire, indubitablement, et un auteur à suivre.
Retour au sommaire
Luc Dellisse, Belgiques, Ker éditions, 2021.
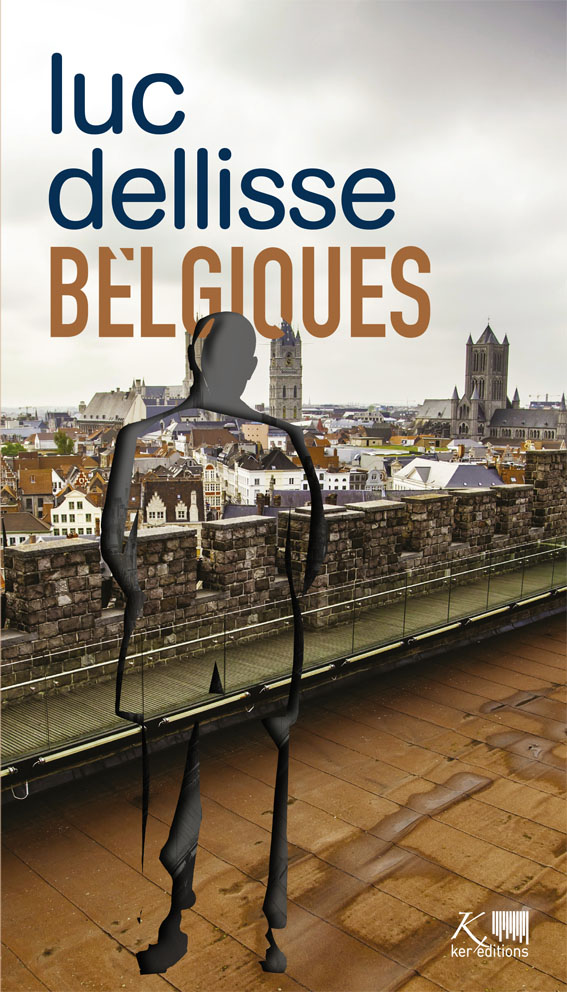
« Les voyages dans le passé ne finissent jamais. » Tel est le constat des quinze narrateurs de ces nouvelles, dont on comprend vite, à leur haute taille, à leur parcours, à leurs comparses récurrents, qu’il ne s’agit que d’un seul homme suffisamment proche de l’auteur pour piéger le lecteur dans la suspicion de l’autofiction. Ce serait perdre le suc de ces nouvelles : par l’atmosphère complice, la maladresse sympathique des personnages, les décors quotidiens relevés par un détail bien choisi, elles parlent aussi, et peut-être avant tout, de nous. Leur fil rouge est le retour en Belgique du narrateur, longtemps expatrié. Les lieux, les hommes, les souvenirs renouent peu à peu le passé au présent, chaque nouvelle portant la date, non de sa rédaction, mais de l’anecdote rapportée, sans ordre chronologique, de 1969 à 2021. Réminiscences ténues, parfois, qui s’entremêlent avec des visites plus récentes à ceux qui « possèdent une des clés de [s]on passé ». Les contours se précisent, des personnages resurgissent, « on s’accroche aux éclairs de bonheur. » Ultime pirouette, la clé de l’intrigue est rarement fournie, mais le lecteur, mis sur la piste par certains détails, prolonge sa lecture dans les hypothèses qu’il formule. « Il n’y avait plus qu’à l’écouter me confier son secret des secrets » : ainsi finit un nouvelle fort pertinemment intitulée « Les mots couverts »…
Le charme de ces nouvelles, plus que dans l’intrigue assez ténue, réside dans les atmosphères feutrées, intimes, vaguement mystérieuses même en pleine lumière, mais qui parfois se révèlent brusquement dans leur excès. Un détail suffit à créer une ambiance — une tenue mal boutonnée, un ascenseur miraculeux, des lunettes noyées par la pluie, les lianes des draps de lit… Alors se déploie le « grand kaléidoscope de la mémoire nocturne » ou le « grand mouvement hypnotique de la lecture ». On entre dans « un royaume d’étangs gelés, d’arbres en squelette et de toits lissés par la blancheur des sommets », on entend « craquer la journée crayeuse contre les fenêtres qu’on n’ouvrait jamais ». Parfois, la description s’élargit dans un décor dantesque, dans des exagérations épiques qui nous emportent dans un tourbillon verbal pour nous abandonner pantois à la page suivante. Une tempête donne au promeneur imprudent l’impression de naviguer en pleine mer, un café bondé « d’obèses rougeauds généralement sertis dans une cache-poussière ensanglanté » sécrète « un poisseux lichen de bière et de fumé », les abattoirs exposent des statues de viandes pendues à d’immenses porte-manteaux à roulettes, par ordre de taille, comme les frères Dalton…
Le personnage qui se met en scène dans ces décors singuliers se montre discret, presque effacé, il se présente comme un solitaire timide, comme affecté d’un complexe d’inexistence dans un monde aussi présent. Observateur méticuleux, il semble prendre ses distances avec le monde, se « replie » dans un quartier perdu ou voyage comme on s’enfuit. Est-ce cela qui le décide à prendre la plume ? « Je serais écrivain, je serais le petit homme éveillé qui n’a pas de corps, juste une âme collective, une voix sans visage. » Mais ce timide — pour se rassurer ? — est aussi un sensuel et un séducteur qui reconnaît lui-même son « manque parfait de sens moral ». Parfois, il joue un rôle, se coule dans une « fausse apparence, un mensonge permanent », comme une carapace qui dissimule la timidité foncière. Une autre façon de n’être pas lui-même ? Le décalage temporel, lorsqu’il retrouve le pays de son enfance, accentue cette impression d’inconsistance : si le personnage vieillissant ne se reconnaît plus qu’imparfaitement dans le jeune homme qu’il a été, peut-il encore croire à la permanence de l’homme ? Vieillir, en fin de compte, c’est peut-être céder le pouvoir à « la vieille femme que chaque homme porte en soi et qui grandit avec les années ». Reconnaître, une fois pour toutes, que nous avons toujours été un autre.
Retour au sommaire
François Coupry, L’agonie de Gutenberg, vilaines pensées 2018/2021, FCD Livres, 2021.
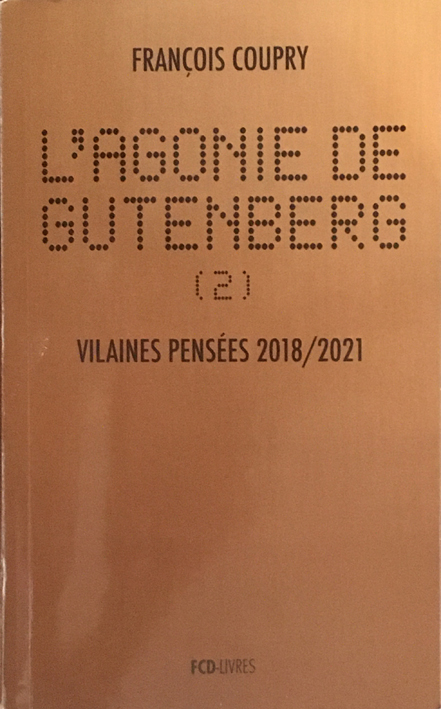
« Stop ! Coupry, arrêtez d’écrire ces fanfaronnades : on ne sait à quel niveau de récit vous vous situez. » Fanfaronnades ? Si vous le dites… François Coupry, lui, parle plutôt de fables, de saynètes, de contes iconoclastes… Chaque semaine, du 10 janvier 2018 au 5 mai 2021, ses personnages fétiches (car lui n’apparaît qu’occasionnellement) ont tenu un journal décalé où l’humour pince-sans-rire ouvre des abîmes de réflexion. Il revendique la filiation de Swift et de Kafka, auxquels on pourrait ajouter les contes de Voltaire, les Lettres persanes ou les aventures du docteur Faustroll… Le lecteur du premier tome y retrouvera avec bonheur l’inénarrable Piano et son petits-fils Clavecin, tous deux passés maîtres dans « l’art de parler en public pour dire ce qu’il ne fallait pas », mais aussi l’aigle de Xi, qui n’aime que le risotto aux asperges ; l’âne astrophysicien, Wofgang von Picotin ; le chien métaphysicien, Tengo-san ; un lion philosophe ou un singe Bonobo de l’île X… Tous possèdent au plus haut point le génie du paradoxe et ne se gênent pas pour proférer avec la plus parfaite assurance les pires horreurs sur l’actualité, la canicule, les gilets jaunes, les investissements boursiers ou l’héritage d’une vedette rock. Dans la lignée de Micromégas, les Martiens viennent commenter les élections de 2020 auxquelles, apparemment, ils n’ont rien compris. Apparemment, car c’est peut-être nous qui nous berçons d’illusions sur le monde politique. Le renversement systématique des idées et des valeurs auquel nous invitent ces textes n’est que la conséquence de ce décalage de point de vue.
Car tel est le pouvoir de la fiction : en posant un masque sur le masque du réel, elle paraît bien plus vraie que celui-ci. Et pour cause : selon une théorie chère à l’auteur (ou du moins à ses personnages, puisqu’eux seuls existent vraiment), la fiction ne serait pas le reflet du réel, mais ce sont les fictions qui créent les vérités. La « fabrication incessante du réel par les récits » est le vrai sujet de ces courts textes conçus à l’origine comme des post de Facebook (où ils continuent leur prépublication). Cette conviction, défendue depuis les années 1980 par François Coupry, n’attendait que le monde virtuel des réseaux sociaux pour passer du paradoxe à l’évidence. Tout ce que nous vivons existe de toute éternité dans le grand réservoir de l’Imaginaire et se réalise de manière différente selon les époques. Il suffit donc de rejoindre ce grand vivier pour changer d’époque, en empruntant les « couloirs du temps » familiers aux personnages de François Coupry.
Une fois admis ce principe, le monde de l’auteur est d’une impitoyable cohérence et d’une redoutable lucidité. Que peut faire la Beauté déçue de ne pas être harcelée ? Porter plainte pour indifférence. Que devient l’homme dans un monde où, par les réseaux sociaux et le deep learning, on sait tout de lui ? Il meurt aussitôt, « dénudé », rendu inutile par l’exhaustivité des informations le concernant. L’absurdité est présentée de façon impassible. Dans un monde où les hommes accouchent, l’un d’eux enfante sa propre mère. Mais s’il viole sa fille (c’est-à-dire sa mère), l’enfant qui en naîtra sera-t-il lui-même ? « En une république, le roi signa une ordonnance… » Rien ne vous étonne ? Attendez… L’ordonnance autorise les trains à ne pas partir aux heures annoncées. Pourquoi pas ? La cohérence, la logique interne du récit, part de ces prémisses absurdes et en analyse les conséquences avec rigueur. Les gares se retrouvent encombrées de voyageurs qui ne savent pas quand leur train va partir. Pour les faire patienter, elles deviennent des lieux de convivialité et de culture et, de fil en aiguille, au terme d’un raisonnement serré, le pouvoir d’achat a grimpé en quatre jours et le taux de chômage diminué.
« Ou bien, un autre version », nuancera l’auteur. Croit-on être entré dans la logique du conte ? « Cela prouvera que vous êtes bel et bien un être humain, désireux de trouver une logique à n’importe quoi. » Car dans un monde en perpétuelle mutation, rien n’est assuré, rien n’est stable. Chacun y joue un rôle, à tel point que Clavecin, petit-fils de Piano, se transforme perpétuellement, en animal ou en dictateur – Kim-de-Corée-du-Nord, Xi Jimping ou Trumpi-Trumpo… Il ne fait en cela que porter à ses conséquences ultimes l’exemple de son grand-père, qui peut dans le même temps se faire huer et applaudir par le même public. Qu’importe ? Toutes ces identités successives ne sont que supercheries. Démocrite aurait dénombré une centaine de dirigeants historiques qui ne seraient en fait que des fantômes ou des paravents. La liste va d’Ivan le Terrible à Staline ou à Kennedy…
Mais les pires de ces illusions sont celles qui nous promettent un monde meilleur. Nous vivons ici des revirements subits, des révolutions continuelles qui nous mènent vers un progrès invraisemblable : le chômage baisse, les glaciers reprennent des forces, la couche d’ozone se reconstitue… Il suffit pour cela d’une décision insolite : diminuer la taille de l’être humain, décréter que 2 + 2 = 12. Il suffit, pour faire basculer la réalité, de prendre une expression courante au pied de la lettre : quand on est dans sa bulle, la bulle est concrète et se métamorphose en œuf ! L’absence de règle devient la règle.
Cet éclatement incessant de la cohérence du monde et des personnages finit par donner le tournis, du moins à ces derniers, qui s’enfuient et partent se réfugier dans le passé — essentiellement dans la France des Lumières — retrouver des figures souvent mise en scène par François Coupry. La fuite n’est pas une solution. Mais si le monde que l’on fuit n’est lui-même qu’un simulacre, la fuite ne nous livre-t-elle pas une paradoxale vérité ? « Si les récits historiques mentent, la cause n’est point un complot universel, mais tout bêtement la difficulté de raconter sans simplifier, enjoliver, mythifier, mettre en ordre narratif et cohérent la multiplicité chaotique du réel. Alors, on utilise le charme du conteur, et le désordre prend un sens, factice mais facile à enregistrer, à répercuter. » Derrière la fable se dissimule non pas une morale univoque, mais un appel à donner sens au grand Chaos qui nous entoure. Ou à en rire, tout simplement.
Retour au sommaire
Voir aussi : Les trois coups du cavalier chinois ; Les souterrains de l'Histoire; Où est le vrai Louis XVI ?; La femme future; Le grand cirque du cavalier chinois, Zeus et la bêtise humaine, Le fou rire de Jésus. L'agonie de Gutenberg (1).
Michel Brix, Du classicisme au réalisme, Une histoire de la littérature (XVIIe-XXIe siècles), Kimé, 2021
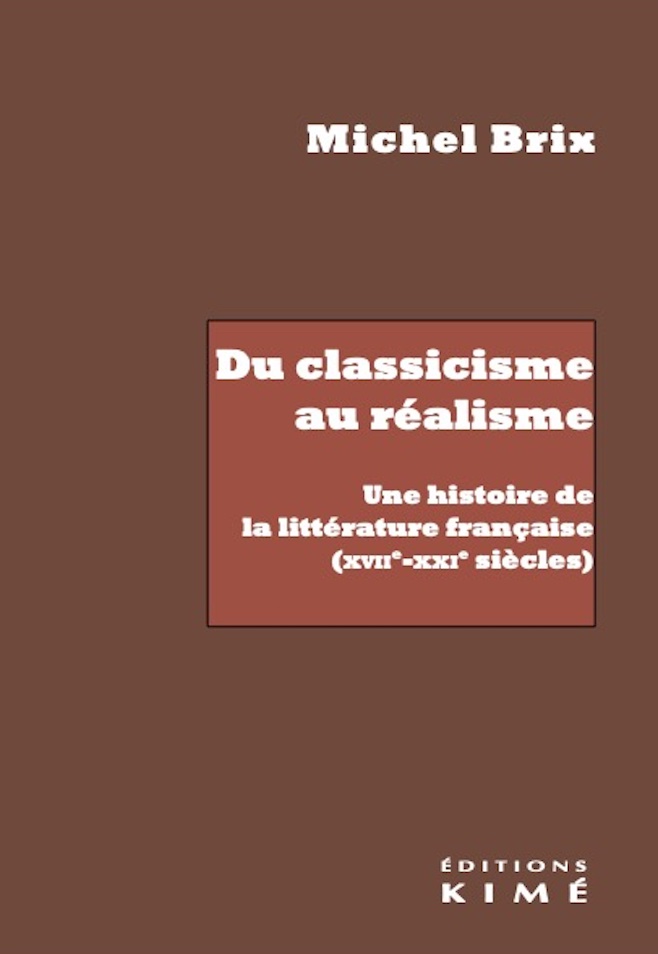
Quatre siècles d’histoire de la littérature, même en trois cents pages, c’était un fier défi à relever. D’autant que le propos n’est pas de recenser les courants, écoles et chapelles qui se sont multipliés comme les petits pains à chaque génération, mais, à l’inverse, de réduire ces multiples mouvements à deux grandes tendances, le classicisme et le réalisme, et de montrer comme la littérature française est passée de l’une à l’autre. Réduire impose d’isoler la substantifique moelle de tous les éléments pour les opposer ou les regrouper de façon convaincante. Un fameux défi, ici encore. Disons-le tout de suite : l’analyse est convaincante et nous oblige à sortir des cadres confortables de l’histoire littéraire traditionnelle.
L’évolution se manifeste dans la seconde moitié du XIXe siècle avec un point de basculement en 1852, année de parution d’Émaux et camées de Théophile Gautier. Le modernisme, dans les arts plastiques, la modernité en littérature, renoncent alors à la notion d’utilité dans les arts — on se souvient de la formule de Théophile Gautier : « Il n’y a de vraiment beau que ce qui ne peut servir à rien ; tout ce qui est utile est laid. » On parle alors de « revendication autotélique de l’art », c’est-à-dire que celui-ci devient son propre but (télos), qu’il ne renvoie qu’à lui-même et rejette toute idée d’utilité sociale. Autrement dit, « l’art pour l’art ». Telle est l’idée fondamentale, dont toutes les autres vont se déduire. Précisons que classicisme et réalisme sont des tendances qui se partagent la littérature française depuis la Renaissance : la « révolution » n’est qu’un changement de majorité… Il convient donc d’étudier également la modernité dans ses racines et le classicisme dans ses survivances.
L’esthétique classique ne se manifeste à l’état pur que dans une partie, mais la plus connue, de la littérature française du XVIIe siècle. L’artiste, sous Louis XIV, est investi d’un rôle social qui lui impose certaines règles, un « art » de faire qui se concrétise par des usages et des préceptes. Il s’inscrit en cela dans la ligne d’Aristote et privilégie l’imitation des anciens, censés avoir porté cette exigence à son plus haut point. Il en résulte un rapport particulier à la vérité et à la vraisemblance. L’artiste ne doit pas décrire (le vrai), mais persuader (par le vraisemblable). Il n’a pas à transcrire la réalité, mais à faire apparaître les lois qui la régissent, jusqu’à fausser la réalité lorsque celle-ci n’est pas vraisemblable. On se souvient que Racine attribue à Œnone les accusations proférées par Phèdre contre Hippolyte pour des raisons de vraisemblance : « J’ai cru que la calomnie avait quelque chose de trop bas et de trop noir pour la mettre dans la bouche d’une princesse qui a d’ailleurs des sentiments si nobles et si vertueux. » Par conséquent, l’art rejette tout ce qui peut apparaître accidentel ou conjoncturel : le « je » autobiographique (ce n’est pas l’exemple isolé qui intéresse, mais la vérité généralisable) et l’actualité (qui n’est pas passée par le filtre de la vraisemblance). Il ne s’intéresse qu’aux lois immuables qui peuvent être utiles au lecteur, soit pour corriger sa conduite (en particulier le garder des passions et de l’hybris, la démesure), soit pour enrichir son expérience et le mettre en garde contre les pièges de la vie. Selon la formule de l’abbé Prévost, le roman doit être « un traité de morale, réduit agréablement en exercices ». Ainsi peut-on lire Sade comme un moraliste, qui dénonce en les mettant en scène les prédateurs qui détruisent la vertu. À l’inverse, la vraisemblance (et non la vérité) permet d’admirer l’homme tel qu’il devrait être et de détourner le lecteur de la barbarie, en donnant forme aux modèles qui, étant d’origine divine, ne peuvent être pernicieux. L’esthétique repose tout entière sur l’identité platonicienne entre le Bon et le Beau : la contemplation du Beau nous détache de nous-mêmes et nous inspire un désintéressement momentané.
Cette approche a l’intérêt de nuancer le lieu commun selon lequel le XVIIIe siècle aurait prolongé le classicisme du XVIIe. Miche Brix montre plutôt comment il a à la fois « détricoté » le paradigme classique tout en mettant en place les caractères de la modernité. Le roman — parce qu’il est en prose et n’a pas de modèle antique prestigieux — permet de dépasser l’imitation des anciens. Plus que la tragédie, il permet d’explorer des sujets modernes, donc de privilégier le « vrai » sur le « vraisemblable » (les événements qui sont encore dans les mémoires) et de donner plus de place au « je » (les références morales sont en l’homme et non dans l’héritage du passé). Deux évolutions fondamentales dans le basculement vers le « réalisme ». Par ailleurs, on croit de moins en moins à des types idéaux que l’auteur aurait pour ambition de déceler derrière l’accidentel. Montesquieu montre que les régimes politiques dépendent des circonstances particulières, comme le climat ; Winckelmann, que l’art antique était lui aussi lié aux conjonctures. L’intérêt pour les littératures nationales, authentiques (les minnesänger allemands) ou apocryphes (Ossian) va dans le même sens : Homère n’est plus considéré comme un modèle universel, mais comme une « antiquité nationale » de la Grèce, parmi d’autres. Ce relativisme contredit l’universalisme classique. Et puisqu’il n’est plus question d’imiter la perfection antique, le critère d’originalité, appelé à un brillant avenir, s’impose dans la critique artistique.
Avec ces clés, on comprend les multiples évolutions qui vont marquer la littérature du XVIIIe siècle. L’apparition de l’autobiographie et des « confessions » (le retour du « je »), le passage du merveilleux (qui reste vraisemblable, puisqu’il met en scène des types universels transposés dans un autre cadre, avec par exemple des animaux qui parlent) au fantastique (qui cultive l’invraisemblable), de l’utilité de l’art à sa gratuité, de la critique dogmatique (ou morale) à la critique biographique ou esthétique, de la perfection métrique au lyrisme poétique, du critère du Bien à celui du Sincère…
Le XIXe siècle n’aura qu’à prolonger ces tendances, qui deviennent alors majoritaires, jusqu’à les caricaturer. Ainsi, le dandy porte à son comble la recherche d’originalité, laquelle devient la pierre de touche de la qualité : « vous ne ressemblez à personne », écrit Flaubert à Baudelaire ; « Vous créez un frisson nouveau », ajoute Victor Hugo… L’abandon de la métrique (toute contrainte empêche l’auteur de « se dire » librement) voit apparaître des mètres nouveaux, disloqués comme le trimètre romantique, puis le vers libéré, le poème en prose… Au bout du compte, on invente le thème devenu classique de « l’écrivain qui écrit un roman sur l’écrivain qui écrit un roman », qui est à la littérature ce que la crème à la crème est à la cuisine normande, s’il faut en croire Gosciny. Ainsi s’explique le stream of consciousness (flux de conscience), qui installe le lecteur dans la tête du narrateur et renonce au narrateur omniscient. Mais aussi la doctrine de « l’art pour l’art », qui indique que le public n’a plus rien à attendre de l’œuvre littéraire, désormais consacrée à célébrer la virtuosité de son auteur — un point sur lequel on peut émettre certaines réserves, le culte de l’écriture ne se réduisant pas à une jouissance nombriliste de l’auteur.
En cela, les différentes écoles du XIXe siècle se résument à une seule tendance : elles révèlent la personnalité de l’auteur et non un type universel. Romantisme, réalisme, symbolisme… concourent au même but. La critique littéraire se tourne alors vers l’auteur, grâce à l’interview, mais aussi l’interprétation biographique des œuvres. L’œuvre n’a même plus besoin d’exister : la vie de l’auteur devient son œuvre. Un « syndrome de Des Esseintes » qui sera poussé à ses ultimes conséquences : Rimbaud, cessant d’écrire, reste poète — « quand, affolé, il finirait par perdre l’intelligence de ses visions, il les a vues », affirme la « lettre du voyant ».
Bien sûr, une révolution de cette ampleur ne s’effectue pas en une génération. De même qu’il y eut, au XVIIIe siècle, des signes avant-coureurs de la mutation, il y eut, au XIXe, des résistances au modèle réaliste. Celles-ci peuvent nous étonner si l’on reste dans les schémas classiques d’interprétation, mais s’expliquent tout à fait dans l’optique des pages précédentes. Ainsi, Stendhal, Chateaubriand, Balzac, Hugo, Dumas, George Sand conservent un pied dans le classicisme. Et si la seconde moitié du XIXe tente l’expérience « réaliste », ce n’est pas par l’adéquation parfaite à la réalité, mais par des « effets de réel » qui en donnent l’illusion. La sincérité de l’auteur, l’authenticité de l’histoire, deviennent les pierres de touche de la qualité littéraire. Bien des questions qui reviennent de façon obsessionnelle dans la critique actuelle s’inscrivent en fait dans ce changement de mentalité deux siècles plus tôt. L’attention portée aux auteurs féminins (censés plus sincères), aux auteurs non professionnels (moins artificiels, n’importe qui pouvant devenir écrivain puisqu’il s’agit d’exprimer sa personnalité) ou oubliés (moins sensibles à leur image idéalisée), à la vie des écrivains (qui doit correspondre à leur œuvre)… Cela conduit paradoxalement à un nouvel élitisme : l’aristocratie devenant une artistocratie, le succès devenant un signe de compromission et l’insuccès, un titre de gloire
Telle sera la revendication du XXe siècle : devant la statue de l’auteur, dont l’œuvre constitue le socle, le lecteur n’a plus qu’à mettre chapeau bas et se taire. Les analyses d’auteurs aussi différents que Gide, Genêt, de Gaulle, Bernanos, Mauriac, Green, Malraux… peuvent sembler convaincantes — si elle n’entraînaient pas dans la tête du lecteur autant de contre-exemples. Car il reste un malaise lorsqu’on aborde la période contemporaine, plus connue du lecteur, mais à laquelle n’est accordé qu’un petit nombre de pages. Malaise qui s’accentue lorsqu’il s’agit de dédouaner la critique (journalistique ou universitaire), qui n’a pu déceler une figure marquante depuis les années 1970, alors qu’elle pourrait au contraire être accusée d’avoir négligé les auteurs singuliers au profit de modes éphémères et de best-sellers soigneusement promus par leurs éditeurs. Il est un peu facile, après des années où journaux et universités ont encensé le nouveau roman, l’autofiction ou la littérature minimaliste, de conclure que « l’imagination est le parent pauvre de l’esthétique moderne ». On peut suivre l’auteur dans son constat pessimiste sur les apories de l’esthétique réaliste poussée à son extrême. On ne peut s’empêcher de penser que si la critique universitaire, depuis les années 1980, avait prêté un peu plus d’attention aux écrivains qui s’en étaient affranchis, ou qui, comme les romanciers de la Nouvelle Fiction, ont réussi à définir une esthétique originale qui se distingue aussi bien du classicisme que du réalisme, des tendances émergentes auraient pu s’imposer.
Retour au sommaire
Voir aussi : Libertinage des Lumières et guerre des sexes.
Stéphane Lambert, Paul Klee jusqu’au fond de l’avenir, Arléa, 2021.
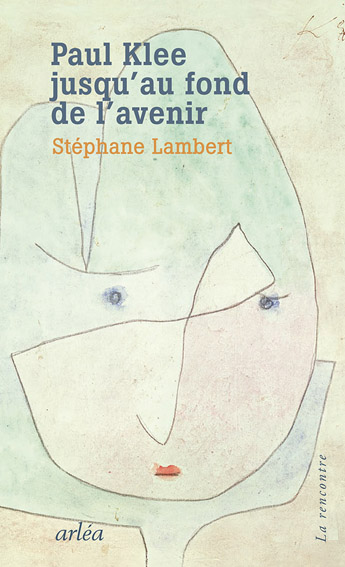
Il n’est pas facile d’évoquer par les mots le travail d’un peintre. Stéphane Lambert, également romancier, s’y risque par l’intermédiaire du récit personnel. Le livre épouse le temps du voyage, la visite au Zentrum Paul Klee, en Suisse. Artifice classique et quelque peu éculé, pourrait-on croire. Mais au fil du livre, on comprend qu’il n’en est rien. Comme dans la théorie de Haeckel, le voyage devient une récapitulation abrégée et rapide de la vie de Klee. Les deux temps se conjuguent en un fascinant jeu de miroirs.
De même, ce qui semble au départ une réflexion philosophique générale et assez banale sur la perception de la réalité finit par structurer l’ouvrage. Ce que nous voyons est une reconstruction de l’actualité, nous explique l’auteur, mais le fait que plusieurs personnes puissent s’entendre sur la présence d’un objet atteste de sa réalité. Mais qu’arrive-t-il si l’objet disparaît ? La préservation de son existence est aléatoire. La mémoire trahit ; la photographie ment. Le peintre seul « débusque la présence là où elle se dissimule ». Voilà qui nous amène à Klee, dont le travail ne se réduit pas à une restitution du réel, ni à sa transposition gratuite par une géométrie désincarnée, mais interroge son origine et sa destination. « Le début et la fin y siègent côte à côte comme deux rois déchus et souverains. Fossile et Talisman pourraient être leurs noms. L’énigme de l’origine épousant le flou de la destination. »
J’avoue n’avoir jamais été sensible à la peinture de l’artiste suisse. Mais pour la première fois, j’ai eu l’impression de disposer d’une clé capable d’ouvrir une porte. Le travail sur la couleur, par exemple, se comprend dans cette tension entre origine et destination. L’envoûtement des couleurs passées est à la fois un « retour au Chaos » et un appel vers le futur, « l’éveil d’une matière cachée dans la matière ». Le recours à la paréidolie, cette capacité à reconnaître des formes familières dans le hasard d’un nuage ou d’une tache, permet de donner sens aux formes, aux couleurs, à la géométrie… « Deux petits cercles surplombent un fin rectangle : et un visage apparaît. » On comprend, ou du moins on admet, l’usage des formes élémentaires : « Le moindre suffit pour planter le décor. » Et l’implication personnelle de l’auteur dans le livre, qui pouvait agacer au départ, prend tout son sens. « Qu’est-ce qu’une image sinon un instant capté avant sa disparition ? » se demande Stéphane Lambert. L’instant de la création et l’instant de la perception se confondent. Le voyage de l’auteur correspond au temps de captation de l’œuvre, avec ses épiphanies et ses ruptures. La neige matinale devient une mise en condition, sinon un élément d’intellection de l’œuvre regardée. « Plus rien ne serait comme avant. » Voilà qui invite le lecteur à prolonger l’expérience.
Cette approche sensible est servie par une écriture artiste qui, par moment, peut aussi agacer. Elle est faite d’allitérations (« un ingénieux jeu de jonchets », « borborygmes et barbarie vont de pair »), de concrétisation de l’abstrait (« je patauge dans la vase de ma pensée »), d’images fortes (« la maladie agit comme un engrais sur la profusion de l’œuvre »), qui par moments déconcertent et déconcentrent. L’hôpital se moquant volontiers de la charité, je dois admettre que ce qui m’agace le plus dans ce défaut, c’est qu’il est aussi le mien… Stéphane Lambert s’exprime par sentences bien ciselées, mais un peu mystérieuses, qui se juxtaposent pour essayer de se donner un sens. « L’ignorance du profane défie l’ironie du ciel. L’ombre de la mort est un sourire coloré. » On admire, on goûte, mais on n’est plus dans le dépouillement de Klee. Encore une fois, j’aurais mauvaise grâce à reprocher à un confrère ce dont j’abuse tout autant. Peut-être, tout simplement, peut-on regretter dans cet art brillant de la formule un ton souvent péremptoire, qui se traduit par l’importance du verbe être : « l’art est », « l’idée est », « l’infini est », « l’homme est », « peindre est », « la mythologie est »… Alors que le parcours est nécessairement subjectif, puisque fondé sur la perception personnelle de l’auteur, le partage avec le lecteur ne s’en trouve pas facilité, malgré l’invitation (« Entrez, entrez. Suivez-moi au cœur de cet univers béant… »). Mais le plaisir jouissif de la lecture et la découverte d’une clé d’accès à l’œuvre de Klee désarment bien volontiers toute critique.
Voir aussi : L'Apocalypse heureuse. Vincent Van Gogh, L'éternel sous l'éphémère.
Retour au sommaire
Gabriel Ringlet, Va où ton cœur te mène, Albin Michel, 2021.

« Je n’ai jamais vu d’aussi près un miracle endormi », note Gabriel Ringlet à la naissance de son filleul, Élie. Pour lui (et pour notre plus grand plaisir), il va faire revivre le prophète biblique dont l’enfant porte le nom. Biographie romancée, essai historique, réflexion philosophique, voire vaste poème en prose, le livre tient de tout cela. On y trouvera surtout Élie dans les textes bibliques, bien sûr, mais aussi dans la tradition chrétienne, juive, musulmane — et au-delà, on y trouvera un message pour notre époque. Car Élie continue à passer, à se mêler à nos conversations, à nous inspirer… À travers le personnage, l’auteur nous parle du monde moderne, piégé entre le fanatisme destructeur et l’apathie matérialiste. « Il y a urgence à voir se lever des héritiers de ce souffle brûlant », dit-il aux seconds ; « Mais d’une brûlure douce comme une caresse », ajoute-t-il pour les premiers. Élie, c’est « un feu de douceur et non feu adouci », un « déchiffreur d’aujourd’hui »… Pas un terroriste.
Quoique… On se souvient des prêtres de Baal égorgés par Élie et de Jézabel défenestrée et jetée aux chiens. La violence vétérotestamentaire se déchaîne dans toute son horreur dans l’histoire d’Élie. Son engagement total « pousse Dieu à être encore plus Dieu », et nous donne froid dans le dos. D’où la nécessité de prendre nettement ses distances avec certaines époques de sa vie. Le « prophète m’as-tu-vu » qui engage un duel d’holocaustes et qui tue de sa main les perdants n’est pas celui de Gabriel Ringlet. Dieu peut-il faire perdre la raison, se demande-t-il, et nous savons aujourd’hui qu’en son nom les pires atrocités peuvent être commises. Ce massacre est non seulement insupportable, dit-il nettement, mais n’est pas une expression de la foi. Élie s’invente un dieu à la hauteur de son orgueil. Et pourtant, cet Élie du Carmel est celui que l’Histoire a retenu. Il est temps de dénoncer fermement ces passages. « Est-il si grave de n’avoir pas le même dieu ? Ou de n’en avoir pas ? » Aujourd’hui, la question ne se pose plus, on l’espère.
À l’Élie du Carmel, il faut préférer le poète de la fragilité divine et celui du « juste assez ». Celui des premiers miracles de sa « geste ». Les jarres inépuisables offertes à la veuve de Sarepta contiennent « juste assez » d’huile et de farine pour son pain quotidien. De même, lorsque Gédéon se plaint à Dieu de ne pas avoir assez de force pour combattre les Madianites, il lui est répondu : « Va avec la force que tu as. » Telle est l’autre face du prophète de l’Ancien Testament : on ne demande pas plus à l’homme, ni à Dieu, que ce qu’il peut donner, et ce qui suffit. La conversion ne passe pas par l’arrachement, mais peut s’exprimer « dans la sobriété du peu ».
Le peu, le juste assez, le presque rien, philosophes et poètes ont appris à s’en contenter, voire à y glisser tout un infini. N’était-ce pas jadis la mission du prophète, et aujourd’hui du poète, d’éveiller de souffle – de faire naître le poème que chacun porte en soi. « Entrer dans le poème est une manière de vivre », nous dit Gabriel Ringlet. Le poème « vit avec nous dans l’ordinaire des jours. » La discipline quotidienne qu’il se propose en réinvestissant le texte biblique peut être plus largement pratiquée, dans un cadre athée aussi bien que religieux. Quant au fameux manteau d’Élie, qu’il finit par jeter sur son disciple Élisée pour lui transmettre sa mission, chacun de nous peut reproduire le geste à sa manière, avec la force qu’il a. Chacun de nous peut avoir en héritage « un petit bout » du souffle prophétique « et refaire alors cette jetée créatrice sur quelqu’un qui a faim, qui a soif, qui est nu, malade, étranger ou en prison… » À une époque asthmatique de l’âme, où le souffle (prophétique ou poétique) semble épuisant — ou, à l’inverse, dangereusement destructeur, cet appel au « juste assez », au petit geste quotidien où l’on peut faire tenir l’infini de la poésie, de la foi ou de la compassion, est particulièrement revigorant.
Retour au sommaire
Voir aussi : Effacement de Dieu, La grâce des jours uniques. La blessure et la grâce. Des rites pour la Vie.
Véronique Bergen, Icône H, Hélène de Troie, Onlit, 2021.

À quoi correspondrait le mythe d’Hélène dans le monde actuel ? La revitalisation de vieux mythes est un des exercices les plus stimulants de la création, et celui de la guerre de Troie a fait l’objet de multiples tentatives de ce genre. Mais le roman de Véronique Bergen, me semble-t-il, va bien plus loin, puisque l’histoire se déroule à la fois sur les deux plans historique et mythique, pour mettre à nu l’intemporel, « l’icône H » derrière l’Hélène de Troie et celle d’aujourd’hui, dans un récit dont la tension dramatique et la violence verbale n’empêchent nullement un humour discret mais efficace.
Hélène, la protagoniste autour de laquelle tournent les différents chapitres, confiés au regard d’observateurs différents, est une jeune Bruxelloise de notre temps. Elle a été confrontée dès l’enfance au personnage mythique dont elle porte le nom. Héritage d’autant plus lourd que sa mère a eu le malheur de lui suggérer cette comparaison à un âge précoce. Elle a relevé le défi au pied de la lettre, débaptisant ses proches, parlant en hexamètres dactyliques… Ainsi sa mère, Laetitia, est-elle devenue Léda et sa sœur Caroline, Clytemnestre. Elle a été donnée à un Manuel (Ménélas) pour s’enfuir avec un Pierre (Pâris, qui lui vient de… Paris). Machaon, Amphimaque et Ulysse ne sont autres que Marc, Antoine et Ulrich. Quant à Zeus, le père céleste et invisible ? « Un type qui ne t’a pas reconnue et qui a pris la poudre d’escampette à ta naissance », à moins qu’il ne s’agisse, plus prosaïquement, d’un « aliéné grand cru »… Le jeu est dans une première lecture amusant : les personnages principaux sont en nombre suffisamment restreint pour que le lecteur ne s’y perde pas, d’autant que la première lettre des prénoms et des pseudonymes est identique.
On peut donc lire ce roman comme une adaptation moderne du vieux mythe et goûter avec gourmandise le sel des métamorphoses. Les prétendants sont particulièrement bien croqués : un superstitieux qui craint de s’accoupler à une déesse, un pédéraste converti par la beauté absolue d’Hélène, un pédant qui ressasse ses cours d’histoire de la médecine, un bègue, un gigolo voile et vapeur… La guerre de Troie devient une rivalité entre gangs bruxellois et parisiens, qui prend le prétexte d’une histoire de sexe pour éliminer la concurrence dans les trafics de drogue, les rackets, les cambriolages. On s’arrêtera alors à quelques scènes savoureuses : la pomme de discorde, le jugement de Pâris, le duel entre Ménélas et Pâris… Véronique Bergen fait montre d’une parfaite connaissance de l’Énéide et des mythes liés de près ou loin à Hélène. Les liaisons de celle-ci avec Thésée et Pirithoos, Troïlus et Déiphobe, ne sont pas les épisodes les plus connus du non spécialiste, mais font intégralement partie de l’aventure romanesque.
Pour autant, la romancière se garde bien de suivre fidèlement le fil des événements. « J’espère qu’Homère et consorts me pardonneront de ne pas suivre en ce point la narration officielle », s’excuse-t-elle, précisant ailleurs qu’elle ne se prive pas de faire « des crocs-en-jambe au texte d’Homère ». Hélène est un personnage d’aujourd’hui. Si les enjeux restent des conflits entre civilisations avec des motivations économiques dissimulées, ils prennent une autre ampleur dans notre univers mondialisé que dans la Méditerranée antique. Hélène devient une arme de guerre contre le grand capitalisme : « Oui, on m’utilise pour briser le moral des empires, oui, les Français se sont servis de moi pour mettre K.O. la livre sterling. » Par ailleurs, la jeune fille n’entend pas systématiser les rapprochements entre époques, et veille « à ne pas accrocher [s]es casseroles mythico-psychotiques » aux « neurones bien ordonnés » de « ceux qui pensent que les individus, les époques, les lieux sont étanches ».
Il nous faut alors interroger la troisième Hélène, oubliant celle de Troie et celle de Bruxelles : « l’icône H ». Celle qui n’existe pas par elle-même, mais uniquement par le regard des autres, par le désir qu’elle suscite, dans le « ballet de regards qui ricochent sur [s]es formes ». Existe-t-elle, cette icône, cette image, autrement que comme un reflet ? Là est la vraie souffrance de la protagoniste, et la clé de toutes ses dérives. La violence de ce constat se traduit par celle des mots. Si Hélène a l’impression de se vider de toute substance (« Je suis née avec un petit trou supplémentaire sous le gros orteil, je m’écoule par là »), c’est en écho aux paroles de sa mère : « Je te plains d’être un trou, une cavité que toute la matière de l’univers ne saurait combler. » Alors, toute la matière de l’univers va y passer… Pour se sentir exister, pour combler cette personnalité Danaïde, elle s’offre à tous dans un messalinisme insatiable. C’est le versant sombre de sa personnalité, le néant insupportable et, en fin de compte, absurde — car pourquoi une guerre pour quelqu’un « qui existe moins qu’une mouche, moins qu’une poubelle » ? Un des leitmotive du roman (qui ne va pas sans un humour sinistre) évoque tout ce que les ennemis d’Hélène lui fourrent dans la bouche, comme si l’on pouvait combler son monstrueux néant : un nic-nac en forme de H, une botte de radis, une bible miniature, un bouchon de baignoire, un escarpin, des faire-part de mariage… La sexualité est aussi l’insatiable besoin de combler ce vide ontologique.
Cette sexualité débridée est l’aspect le plus apparent du roman, qui par moments « déchaîne [une] libido overcalibrée Himalaya de sperme ». Ne nous laissons pas détourner par la partie émergée de l’iceberg. L’hypersexualité est un piège qu’Hélène se tend, qu’elle tend aux autres, mais aussi que les autres lui tendent pour résister à la fascination qu’elle exerce : « Une beauté profanée, active sexuellement, désactivée symboliquement, ramenée à l’expression d’une avidité nympho, baisable à merci, qu’on se refile de queue en queue, c’est ça votre vœu. » On touche ici au vieux paradoxe de la misogynie millénaire, qui avilit la femme pour conjurer son pouvoir. Car Hélène, comme chez Goethe, n’est pas seulement une femme : c’est LA femme, « plus femme que toutes les femmes », une « Surfemme » dont l’existence même rallume la véritable guerre, non celle de Troie, non celle des gangs, mais celle des sexes. Les formules sont tout aussi glaçantes : « dans mes gestes, mes mimiques, j’importe une grammaire mâle pour tuer le principe femelle » tandis qu’ailleurs se constitue une « brigade anti-mâles de choc » ou que, plus radicaux, certains rêvent à l’extinction progressive de l’espèce humaine grâce aux pesticides qui défertilisent les mâles ! L’icône H — comme la bombe H ? — devient l’essence même de la Guerre et de la destruction. Sa beauté est son arme. Elle a « l’art de déshiniber le genre humain, de faire sauter ses soupapes de sécurité, réveillant les humeurs animales. » La violence qu’elle suscite à son égard est peut-être une ligne de défense de la part de ceux qui voudraient simplement vivre en « laissant en place les lignes de l’univers »…
Cette violence exacerbée, avec son exutoire sexuel, est à l’image du monde actuel, dont Véronique Bergen dresse un tableau terrifiant. Et aboutit à une culpabilisation douloureuse — si le fils d’un dieu et d’une mortelle est un héros, Hélène se sent à l’inverse « sous-humaine, un accroc dans le tissu des anthropoïdes, une usurpatrice ». Sa « terreur d’être à côté de moi-même » se traduit par une anorexie jointe à une « faim de sacrifice antique ». « Elle ouvre les jambes pour se fermer à la vie ». Car si elle possède à fond l’art de réveiller la bête en son semblable, elle ne peut la réveiller en elle-même, et c’est une des causes de son drame.
Mais il y a un autre néant, celui des mystiques, qui projette dans une autre dimension celui qui s’est dépossédé de lui-même. Elle y a accès, par instants, dans de sublimes extases. « Moi, Hélène, moi qui ne suis pas moi, je suis gratifiée d’une illumination. Je me tiens dans la lignée des sentinelles de l’infini, des veilleurs du néant. La nuit initiatrice de Descartes près de son poêle, la possession d’Aleister Crowley par un ange qui lui dicte le Livre de la Loi, la nuit transfiguratrice de Paul Valéry à Gênes, la conversion d’Augustin, la nuit mystique de Pascal et sa comète le Mémorial et ma révélation ésotérique aujourd’hui ne forment qu’une seule guirlande. La césure qui décolle le temps de lui-même a pour nom Zeus. »
Zeus ? L’absence du père, qui peut à la fois renvoyer au lâche abandon ou à la divinité, fait partie de cette transmutation du personnage en icône. L’agent de cette opération alchimique est une héroïne oubliée que Véronique Bergen a baptisée Électre. Non pas la fille de Clytemnestre et d’Agamemnon, nièce donc de l’Hélène mythologique, mais un personnage étrange et récurrent, la seule qui ne soit pas affublée d’une double identité (« Qui se cache derrière le prénom d’Électre, je suis l’un des rares à le savoir », dira en fin de compte Ménélas) qui ressemble à Hélène (toutes les deux ont un nom composé de trois « e ») mais qui la poursuit d’une implacable haine. Une sorte d’anti-Hélène, comme une antimatière, qui pâtit autant du total silence de l’Histoire sur son compte qu’Hélène souffre de sa sur-représentativité dans les textes : de leur fusion va naître un « vide central » qui comblera enfin l’absence du père. Le chapitre le plus important (et le plus court !) est sans doute le dernier, intitulé « Zeus », comme une ultime révélation — j’en laisse la surprise au lecteur.
On a envie de s’arrêter à cette partie lumineuse du roman, même si elle n’est qu’épisodique. Deux rebondissements, aux derniers chapitres, changent complètement le regard que l’on porte sur Ménélas et sur Électre et donnent à ce grand jeu de massacre une ouverture que le lecteur poursuivra comme il l’entend dans le chapitre final, « Zeus »…
Mais ne quittons pas ce roman fulgurant sans souligner l’importance de la langue, qui fonctionne explicitement comme un moteur de l’intrigue. À plusieurs reprises, Véronique Bergen le souligne, attirant notre attention sur l’étrange prénom composé de trois « e » (ceux qui préfèrent le « e » muet final sont « des rois de la baise » !) ou sur le pouvoir presque physique des mots : « Le mot néant me fissure » ; « Vos mots-balles de riot gun m’ont lézardée canicule », « son sexe durcit et se soulève mais sa phrase tombe, mollassonne », la « syntaxe [est] bourrée de chardons »… On torture par des « atrocités verbales », dont les auteurs classiques ne sont pas les moins efficaces : « À Électre, je souffle du pur Euripide que j’ensemence d’un vers apocryphe ». Qu’il suffise de citer Lewis Carroll, Proust, John Fowles, Céline… pour comprendre l’ampleur du supplice pour le non-initié. D’ailleurs, dans les moments de délire, Hélène « psalmodie pêle-mêle Shakespeare, Pessoa, Albert Cohen, Chloé Delaume, Valère Novarina, Hélène Cixous et autres grands explorateurs des possibles. » Qui y résisterait ?
Quant à la langue de la romancière, elle est à la fois déstructurée et jubilatoire. La priorité est donnée aux tournures directes, dans une syntaxe agglutinante qui se passe volontiers d’articles et de prépositions. L’emploi adverbial des substantifs (« elle testostérone aboiements de colère ») côtoie la dérivation verbale des substantifs : Hélène alice carrolle la durée, castor-polluxe ses frères ; ici on spermatise et là on aquagyme, on s’anthropophage, on charybde de déception en déception. Ne nous étonnons donc pas qu’Hélène soit égisthée par Égisthe et qu’Hector hectolitre ses conseils ! Le grammairien goûtera le recours à des tournures rares, comme l’attribut du sujet par un verbe de mouvement, bien attesté en français par des tournures figées comme « il tombe mort », mais systématisé avec une imagination stupéfiante : on papillonne phalène, on se trémousse panthère, on danse roulette russe… De même pour l’attribut du complément d’objet direct par l’intermédiaire d’un verbe de mouvement (comme, par exemple, dans « il la transporte inanimée ») : « je broie poudre de riz ceux qui improvisent sur ma partition », « tu me feras vibrer sirène de Copenhague », « elle me désintègre nanoparticules ». La guerre de Troie, progressivement élevée au niveau de guerre des gangs, guerre des sexes et guerre contre l’humanité, ne peut se traduire que par cette somptueuse anarchie verbale qui réjouira au plus au point le lecteur teinté de philologie.
Retour au sommaire
Voir aussi : Écume. Clandestine. Moctezuma. Le collectionneur.
Zoé Derlyn, Debout dans l’eau, Rouergue, 2021.
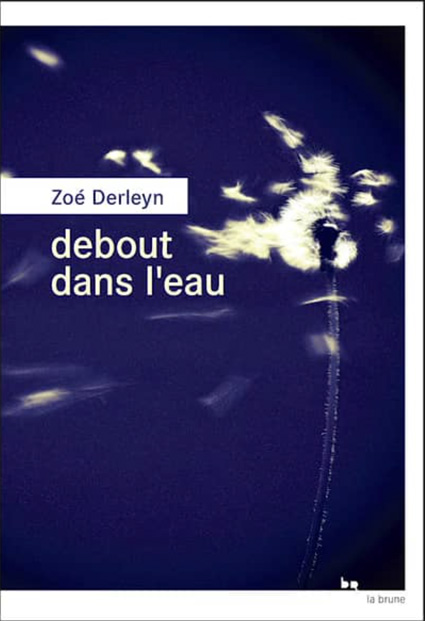
« On voit que tu es née en ville », rit le grand-père lorsque sa petite-fille lui demande où s’arrête le « jardin ». « On voit que tu vis à la campagne », gloussent les tantes citadines quand elle demande si l’eau du robinet est potable. Ces deux réflexions résument bien le malaise de la narratrice, assise entre deux chaises, entre deux mondes, entre deux âges. Elle voit encore le monde avec des yeux d’enfant, avec le sérieux des gamines et la poésie de la candeur, mais découvre peu à peu son regard d’adulte, où la tristesse du désenchantement se conjugue au dégoût de sa propre naïveté.
Entre deux âges, porteuse de nouveaux désirs que les autres ne peuvent deviner, citadine à la campagne et paysanne à la ville, elle ne se sent pas vraiment, non plus, de sa propre famille. Placée chez ses grands-parents par une mère qui semble s’en désintéresser, « à peine la fille de [sa] mère », sans identité propre — elle n’a « les cheveux de personne. Personne, ça veut dire d’une autre famille » — francophone en Flandres — « Je reste dans ma tête, en français » — elle cherche sa place dans le monde. Le « jardin » la lui fournit, ce domaine où le paysage tout entier appartient à son grand-père et où l’étang prend des allures de douves, surtout quand il héberge une baleine !
Le roman oscille dès lors entre l’amertume du rejet et l’enthousiasme de la découverte. La jeune fille s’invente des histoires pour compenser les livres qu’elle ne comprend pas. Elle se heurte aux mots qui trahissent son regard — « Dès lors que les douves ne sont qu’un étang, la maison est juste une maison. » Mais elle découvre des bonheurs d’expression dans le regard aigu qu’elle pose autour d’elle — « Ma grand-mère pèle une carotte comme si elle voulait la punir », le poirier abattu « avec ses racines tordues en l’air comme de longs doigts qui cherchent encore à se retenir. »
Le fil narratif ténu de l’apprentissage — le grand-père qui se meurt, l’intérêt éveillé par un jeune jardinier… — sert surtout à réunir ces trouvailles verbales qui traduisent son rapport malaisé au monde. On y trouve des cruautés d’enfant aux sentiments tranchés — « Je ne suis pas certaine de savoir à quoi ça sert, un grand-père » — « Elle ne sait pas que je suis en train de souhaiter la mort de son fils » — des mal-être de jeune fille qui se découvre — devant le jeune jardinier, elle a « des bonbons collants » dans la gorge, devant sa naïveté, elle ressent de la même manière le dégoût de soi-même : « quelque chose qui a envahi tout mon corps, mes bras, mes jambes, et qui me faisait comme une peau collante de l’intérieur. » Et devant l’interminable agonie du grand-père, elle n’entend plus que « des mots de maladie, d’attente, des mots qui retiennent leur souffle. »
Retour au sommaire
Yves Namur, N’être que ça, Lettres vives, 2021.
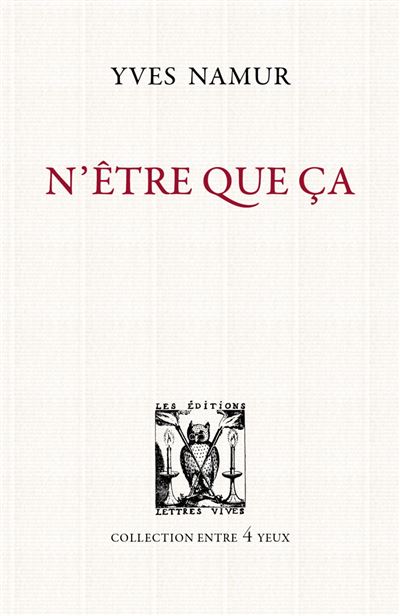
Naître et écrire : pour le poète, un seul et même verbe. Naître ? Au-delà de l’acte si commun qui nous est à tous arrivé sans qu’on le sache ni qu’on en soit responsable, c’est cette intime conviction, un jour, que l’on existe — vraiment, autrement — un retournement — ce que jadis on appelait conversion — une expérience unique et bouleversante. « Je viens donc de quitter, il y a peu, l’abîme du haut et… je nais ! » Une expérience fondatrice, quasi mystique — et même si Dieu, par moment, traverse ces pages, il ne s’agit en rien d’une mystique religieuse. Naître, c’est « entrevoir un pan de cette lumière intérieure » qui soudain éclaire différemment le monde.
Naître, c’est entrer dans une autre terre, qui est à la fois la même et tout à fait autre. Peut-être est-ce pénétrer dans « la terre de personne », qui paraît-il se trouve au Brésil : à notre époque où plus aucune terra nullius n’est donnée à découvrir et à conquérir, la « terre de personne » est une terre « donnée à qui sait regarder au-delà du simple visible ». L’explorateur en est le poète, qui a la faculté de briser la coque du réel. « Un poème arrive, et c’est le monde entier qui vacille. »
Il y a de l’exploration dans le livre d’Yves Namur. Ou plutôt du pèlerinage, un voyage au hasard des associations de pensée, des souvenirs, des images. « Pèlerin sans chemin », il s’aventure « dans le nulle part », avec pour tout bagage « des sacs de pensées vides ou vidées » — peut-être dans ce « pays de Néant vouloir » jadis évoqué par Marguerite Porete. Les guides en sont les oiseaux, qui peuplent ces lignes avec l’insouciance de ceux qui savent. Les mésanges, qui apprennent à picorer sans se poser de question ; les moineaux, indifférents au passage de Lacan, grand épouvantail vêtu de noir ; les pies, qui semblent chercher la parole originelle ; la mouette « qui plane sans fin sur l’î de l’île », et tous les oiseaux migrateurs qui « participent à cette écriture de la pensée ». Leurs apparitions subreptices sont comme un fil rouge tout au long de ces paragraphes qui semblent n’avoir d’autre logique que la digression.
Des oiseaux aux poètes, il n’y a qu’un regard. Ceux-ci ponctuent aussi ces pages de leur présence rassurante — Salah Stétié, René Char, Rilke, Antonio Porchia, Pessoa… Le monde que l’on découvre est aussi celui des livres, des nuages qui passent comme des « livres ouverts » au livre « où tout serait contenu » en passant par celui « qui s’écrit malgré moi ». « Ne suis-je pas moi-même à l’épreuve du livre ? » s’interroge le poète, au sens le plus fort du terme : « L’épreuve, comme une épée noire qui transperce le cœur et le grossit mille et mille fois. »
Entre les oiseaux et les poètes se compose un fascinant paysage où se fondent, se confondent, l’envol et l’écriture, l’errance et l’apaisement. Le livre est conçu comme une lettre envoyée poste restante à une morte, écrite « parce que justement je ne sais que te dire. » Et le miracle, c’est que le lecteur le sait, qu’il voit ce nulle part où l’on chemine, qu’il comprend la « pensée sans maître » — peut-être parce qu’à son tour, il naît.
Naître — n’être — n’être que ça : des miettes pour un oiseau, une trace dans ta main… Oui, décidément, je pense à tous les pèlerins du Néant qui m’ont guidé dans ma propre quête vers le pays du Loin-près de Marguerite Porete. « N’être en fin de compte que ça : un homme qui se tait »
Retour au sommaire
Voir aussi : La tristesse du figuier. Dis-moi quelque chose. La nuit amère.
Otto Ganz, Prière de l’exaltation, maelstrÖm reEvolution, 2021.

« Pleure, dit-elle » : le leitmotiv des premiers poèmes du recueil en pose les thématiques. Un « elle » qui semble renvoyer à la langue, cette « langue / que j’éprouve aveuglée / par l’humeur de tes yeux » lorsque l’enfant voyait l’infinité des teintes contenue dans chaque couleur avant que les mots ne « criblent » les sensations. « Pleure », injonction primordiale à l’enfant qui s’éveille au monde ; triste injonction du mot à celui qui désormais sera sommé de regarder le monde à travers leur filtre. Et que dire des « croyants d’un seul mot », qui ne disposent que du plus ténu des cribles pour percevoir le monde ?
« Pleure », parce que derrière les larmes il y a l’œil, fil conducteur plus discret dans une multitude d’images qui se télescopent et s’enrichissent mutuellement. La vision (les teintes dans les couleurs), les larmes qui brouillent la vue, l’aigle dont la vue se régénère au soleil… Tout cela forme un tout cohérent, qui nous parle de l’illusion et de la lucidité, de leur nécessité à toutes deux, car sans lucidité il n’y a que tromperie, mais sans illusion la vie n’est plus possible. Et les images s’enchaînent, réduisant une à une à la boue, à la merde, à la pourriture, toutes les illusions traquées par la lucidité — les « dieux risibles », les « poètes crédules », l’alliance de l’esprit et de la peau, le terrible mensonge d’une histoire commune, la foi en un au-delà plus serein, la fierté de l’homme réduite à son animalité de singe, de fourmi, de corbeau, d’étourneau, à ses déjections ou à son destin de cadavre.
« Pleure », oui, et « hurle », bientôt, « dit-elle », toujours, « supplie », dans une litanie ascendante qui culmine sur la révolte — « rugis dit-elle charge oui rue » — l’acceptation, puis le pardon, la dure lucidité de celui dont l’odorat s’est imprégné de la pourriture, avant de gravir à son tour la colline suivante : celle de la joie, de l’exaltation.
Pour que gronde une plainte
il convient de tendre la corde
de la réalité à rompre
Et le chant, alors, même faux, même s’il s’étrange ou renâcle, « accouchera / au final de la joie ». Il faut déchiffrer une à une, dans l’ordre du recueil, les injonctions scandées qui culminent sur l’exultation, la louange et la prière, dans un vocabulaire épuré de toute religion. Jusqu’à cette constatation finale : « Sans cœur on n’éprouve / aucune faim ».
Tout poème est d’abord une lecture. Celle-ci n’est que la mienne. D’autres sans doute la contrediront. Mais toutes aboutiront au même constat : on ne sort pas indemne de ce recueil d’une richesse fascinante.
Retour au sommaire
Voir aussi : Pavots, Matière d'être, Du fond d'un puits, Technique du point d'aveugle, Les Vigilantes, On vit drôle.
Patricia Castex Menier, Sylvie Fabre G., Accoster le jour, La Feuille de thé, 2021.

Ce
fut un long voyage
la
nuit à présent
est à quai
(P.C.M.)
Le ton et le thème sont d’emblée donnés. L’écriture est un voyage, en particulier l’écriture à deux, qui rebondit d’un interlocuteur à l’autre, qu’un mot relance comme une escale. Le temps est un voyage, en particulier la nuit, qui nous embarque dans un rêve qui ne connaît ni temps ni lieu. À nous de « terminer la traversée » en arrimant le jour à la terre. Le jour alors sera un nouveau voyage, par terre, cette fois, où il faut avancer pas à pas, trouver un « souffle nouveau ». Avec le vague désir de repartir, de retourner au quai d’où se détacheront de nouveaux navires. Le voyage du temps est circulaire, on sait que la nuit reviendra et l’image de la « roue cosmique » émerge du dialogue.
Autour de cette thématique, les images s’inscrivent tout naturellement dans l’imaginaire commun. Les rêves sont la cargaison des nuits, les cales sont pleines, l’éveil les déchargera. Mais qu’en ferons-nous alors ? Sous la lumière du jour, l’évidence nocturne devient « le lourd bagage de l’énigme ». Il ne faut pas l’alourdir en tâchant de la résoudre, mais la laisser porter par l’écriture, par la poésie, qui appartient au même monde et qui nous déchargera du passé.
Personne ne veut croire
son corps affrété
mais la langue y pense
(S.F.)
« Charger la langue », c’est aussi apprivoiser le passé, comme on longe le fleuve depuis son estuaire pour remonter à la source. D’autres images ouvrent d’autres perspectives dans l’esprit du lecteur, car la lecture aussi est un voyage. Sur le pont du navire restent « les aimés ». Est-ce vers eux qu’il faut se retourner ? Ou faut-il laisser la mémoire veiller « sur le passé heureux » ? Le voyage ne va pas sans ses « brassées d’adieu », sans ses espoirs de découvertes, sans ses renaissances à un monde neuf à chaque aurore. Alors les mots sont des visages de fugitifs « qui hantent au présent » nos souvenirs, dans un autre lieu, un autre temps où vie et mort ne sont qu’un seul et même voyage.
le poème,
séjour des ombres
et gardien des métamorphoses.
(S.F.)
Retour au sommaire
Voir aussi : X fois la nuit, Passage avec des voix, Suites et fugues, Le dernier mot, Soleil sonore, Adresses au passant, Bouge tranquille, Al-Andalus. Chroniques incertaines. L'insinct du tournesol. Cargo. Havres. Contre-jours.
Werner Lambersy, Mémento du Chant des archers de Shu, postface d’Otto Ganz, maelstrÖm reEvolution, 2021.

Le Chant des archers de Shu, voici quelque trois mille ans, évoquait la nostalgie de soldats chinois en campagne contre les Mongols et leur sentiment, à leur retour, de n’être plus vraiment chez eux. La souffrance les a marqués à jamais. En 1915, Ezra Pound en publie une adaptation personnelle, à laquelle fait écho le Mémento de Werner Lambersy. La transmission constitue le cœur même des deux longs poèmes qui constituent ce recueil, jusqu’à la postface d’Otto Ganz qui a son tour s’approprie le texte de Werner Lambersy.
Le premier poème, « Mémento du Chant des archers de Shu », se construit autour d’une formule obsessionnelle, « Nous ne serons plus là » ; le second, « Contumace », se construit autour d’une formule opposée : « Je n’étais pas là ». Le passé, le futur ; le singulier, le pluriel ; l’éternité qui nous précède et celle qui nous suivra. Entre les deux, ce bref passage de la vie où l’on ne fait, en fin de compte, que rejoindre le grand troupeau de ceux qui ne sont plus. C’est pour ceux-là aussi que l’on vit, par contumace, — « Ô vous / mes débranchés de / la surface ». Tous ceux qui nous ont été repris « comme on coupe à table / et au couteau / un fruit tombé de l’arbre ». Cela pourrait paraître désespérant, désespéré ; c’est au contraire apaisé, apaisant. Car « le vide est plein / de vos voix et c’est une chose qu’on n’est / pas prêt de me reprendre ! »
Ce second poème pourrait servir d’introduction au Mémento qui le précède. Ne sont-ce pas aussi les archers de Shu, ces disparus dont nous porterons à tout jamais la trace ? Et en assumant la longue plainte des archers — « Nous ne serons plus là » — le poète ne les rejoint-il pas dans ce lointain passé qui sera notre futur ? Le poème évoque longuement la fin — la fin du monde, la fin de l’homme — dans un camaïeu de rouge qui s’élève au cosmique — l’incendie, le soleil mourant — en se fondant sur le plus banal quotidien — la betterave, le rouge-gorge, les fruits… ou la prétentieuse rosette au revers des vestes. Le rouge du sang, le rouge du feu, le rouge du vin, mais aussi le rideau rouge que le soleil tirera un jour sur le théâtre du monde.
Ici encore, ce qui pourrait apparaître comme désespérant, désespéré, n’est qu’un chant apaisé de confiance. « Nous ne serons plus là ! / Mais nous aurons été » : celui qui a pleinement vécu aura participé à la beauté du monde, et cela, rien, pas même la mort, ne le lui reprendra. Et pour cela, peut-être, lorsque le soleil même s’éteindra, longtemps après les derniers hommes, peut-être le poète se retrouvera-t-il « en filigrane à [son] apothéose ». Oui, ce chant qui s’ancre dans la fin, dans le néant, est un grand chant d’espoir, pour ceux qui sont « pétris de plénitude », car en se fondant au monde ils ont échappé à la contingence. « Souviens-toi comme l’univers / Faisait / De nous la totalité de l’avenir ». Ceux qui ne sont pas là, à l’inverse, sont ceux qui n’ont connu que les fleurs sans parfum, le sexe sans amour. Chanter, même la fin du monde, c’est entrer dans une autre dimension. Nous ne serons plus là… « Mais nous aurons chanté / Dansé bu ri et loué de n’être plus là ».
Cette confiance absolue dans les forces de l’amour, de la fusion cosmique, de la poésie est une constante dans l’œuvre de Werner Lambersy — ce n’est pas un hasard si apparaissent, au détour d’un vers, Ulysse, les komboloï, le chant d’Orphée qui font de ce Mémento un regard rétrospectif sur son œuvre. Rarement elle n’a été si lucide, si évidente, jusque dans ses paradoxes, car en fin de compte, « On meurt / toujours d’un poème sans pouvoir / l’achever ». Qu’importe, puisque le poème nous dépasse et nous emporte avec lui ? En cela, le chant des archers de Shu, qui ne se sentent plus chez eux à leur retour, est un chant de victoire. Le poète, avec eux, a conquis un ailleurs qui échappe au temps et à la destruction.
Retour au sommaire
Voir aussi : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Le Grand poème. Ligne de fond. Le jour du chien qui boîte. Table d'écoute, Les convoyeurs attendent, Dormances, Et plus si affinités, Entrées maritimes. Agendada. Mes nuits au jour le jour.
Dominique Le Brun, Charcot (préface Anne Manipoud Charcot), Tallandier 2021.
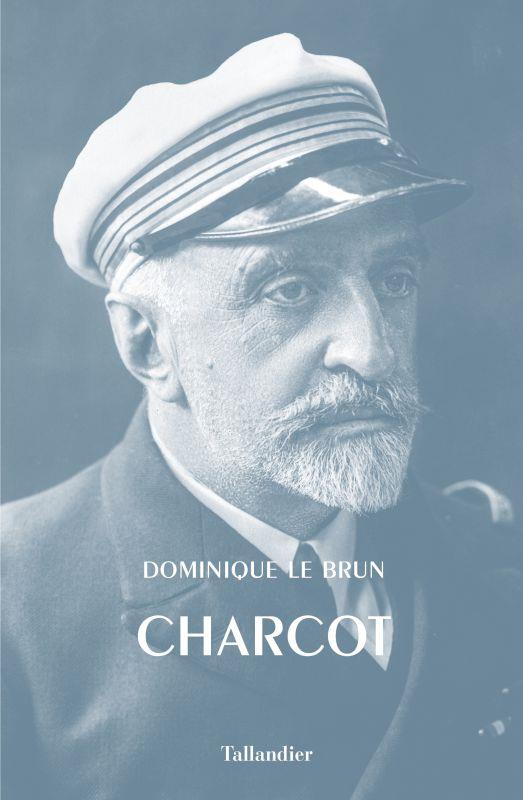
Dans la mémoire collective, le nom de Charcot évoque d’abord un médecin, le neuropsychiatre Jean-Martin, maître de Freud, qui a laissé son nom à une maladie et à un hôpital. Mais les lecteurs de Dominique Le Brun se souviennent peut-être qu’il a évoqué dans Les pôles, une aventure française le destin étrange de son fils Jean-Baptiste (1867-1936). Cette biographie, abondamment illustrée, répondra aux curiosités suscitées par un chapitre de l’exploration des pôles…
À commencer par sa jeunesse dans les traces de son illustre père. La tradition familiale a conservé une vision téléologique de son enfance. Les jeux avec de petits bateaux quand il avait trois ans, la curiosité et l’audace dont il faisait déjà preuve, les bateaux crayonnés dans les marges des cahiers d’écoliers, et cette question qui revenait devant chaque interdit : « Pourquoi pas ? » Tel sera le nom de plusieurs de ses bateaux, et notamment de celui sur lequel il trouvera la mort !
Destiné lui aussi à la médecine, Jean-Baptiste se laisse rattraper par sa passion pour les navires. Et c’est ainsi qu’il sera missionné par le ministère de la Santé pour étudier l’apparition soudaine du cancer dans les îles Féroé. C’est alors qu’il découvre sa vocation d’explorateur polaire. Le polar gentleman, comme on le surnomme, va s’illustrer par ses expéditions dans l’Antarctique. La guerre de 1914 lui permet de mettre son expérience au service de sa patrie en inventant d’ingénieux cargos pièges contre les sous-marins allemands.
Dominique Le Brun, écrivain de Marine, évoque avec la précision de l’historien et l’expérience du marin cette vie d’aventurier à la fois intrépide et humaniste, qui sait que l’organisation d’une fête fait partie de la réussite d’une expédition, qu’une victoire à la guerre ne vaudra jamais une exploration, et qui ne conçoit pas une expédition au Groenland sans sympathiser avec les Inuit... Son livre, bien documenté et d’une écriture alerte, fourmille d’anecdotes d’un autre temps. Ne retenons que celle-ci, qui concerne son père Jean-Martin : fils de charron carrossier, il n’est pas destiné à une carrière médicale. Mais son père souhaite quand même payer des études à un au moins de ces quatre garçons : il leur propose d’essayer tous une année de lycée ; celui qui aura obtenu les meilleures notes pourra poursuivre ses études. On connaît la suite…
Voir aussi : Vauban, L’inventeur de la France moderne, Quai de la douane, Antarctide, le continent qui rendait fou, C'est pas la mer à boire. Erik le Rouge, La saga des vikings vers l'Amérique.
Retour au sommaire
Vincent Delannoy, James Ensor à Bruxelles, Samsa, 2021
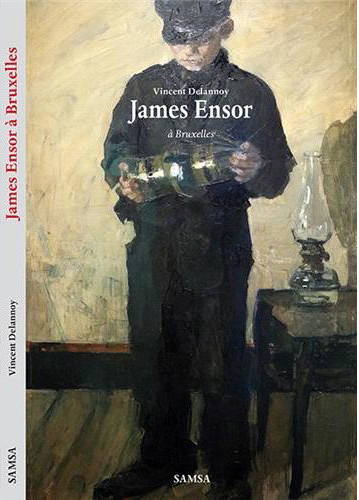
Ensor ? Le peintre d’Ostende… L’image est bien ancrée dans les esprits. Mais pour un peintre belge de la fin du XIXe siècle, le passage par Bruxelles est obligatoire. La capitale est incontournable : là sont les ateliers de gravures les plus performants, les galeristes, les collectionneurs, les musées, les salons et les expositions… Aussi les cercles d’artistes s’y réunissent-ils plus qu’ailleurs. On ne s’étonnera donc pas des liens étroits entre Ensor et la capitale. Cela méritait sans doute un livre qui les détaille et précise les données factuelles : où logeait-il, chez des amis, à l’hôtel, quels étaient ses contacts, comment était-il accueilli ?
Plus difficile à cerner est l’impact de Bruxelles sur son œuvre. Certes, un de ses tableaux les plus célèbre, l’Entrée du Christ à Bruxelles, la met en scène. Mais le peintre ostendais entré sur le lieu de sa gloire et de sa Passion ne pouvait que s’identifier au Nazaréen entrant à Jérusalem. Même montée vers la grand-ville, même accueil, même incompréhension et mêmes souffrances. Et puis, la ville adaptée à la vie moderne par le percement de grands boulevards formait le théâtre idéal pour les représentations de foules. Pourtant, rares sont les tableaux où il utilise ce formidable espace scénique. Bruxelles ne semble pas l’avoir fortement inspiré.
Une monographie de ce type a forcément ses passages obligés : description du Bruxelles de l’époque, accueil de la critique, enquête sur les amis… Mais forcément aussi, les questions qui se posent sont bien plus vastes : on retrouve aussi bien Ensor à Ostende, à Paris ou à Liège, on s’intéressera à sa surprenante perte d’inspiration… La meilleure partie de cet ouvrage — malheureusement fort brève et reléguée à sa fin — naît d’une question toute simple mais essentielle : qu’est-ce qui a permis à des peintres provinciaux de participer à de grands courants nationaux et internationaux ? La réponse est évidente, mais n’est pas souvent évoquée : l’expansion de la communication, le train et la poste. Dans les deux sens, d’ailleurs : si le train permet au peintre de rejoindre facilement la capitale, il permet un développement de la villégiature à Ostende, où se retrouve un public huppé d’amateurs. Cette belle idée, servie par une enquête méticuleuse, aurait sans doute mérité d’être approfondie.
Pascale Toussaint, Une sœur, Onlit, 2021

Lorsqu’elle se rend à l’hôpital pour récupérer les affaires de sa tante décédée, Claire, la narratrice, ne se doute pas que sa vie va s’en trouver bouleversée. La tante Agnès était religieuse depuis ses vingt ans. Et pourtant, dans sa valise, on retrouve des sous-vêtements en dentelle. Et pourtant, elle était gourmande, incapable de résister à du chocolat. Et pourtant, sous son voile, elle avait gardé sa chevelure rousse. « Ils ont voilé Agnès, mais, Lilith clandestine, elle a gardé ses cheveux. » Quelque chose cloche, qu’il va falloir éclaircir. Alors, Claire se met à enquêter. « Dans quel monde étrange vivait-elle ? »
Une enquête familiale, sans doute. Mais de la famille nombreuse (cinq frères et sœurs à la génération de Claire, sept à celle de sa tante), il reste bien peu de vivants capables d’évoquer les souvenirs. Alors l’enquête commence par elle-même. Élevée religieusement avant de prendre ses distances avec la religion durant ses études de pharmacie, elle se sent complice de sa tante, de ses secrets de femme. Elle a vécu l’emprise des religieuses et des prêtres, les peurs savamment entretenues, la tradition d’obéissance. « Accepter est plus facile et réconfortant que refuser, surtout à sept ou huit ans. » Elle a vécu les aspirations à la certitude, avec sa mère pour qui la religion tenait lieu de garde-fou. Elle a vécu, c’est vrai, le ras-le-bol de la vie quotidienne et la tentation de la rupture avec cette course permanente. « Et puis, comme tout le monde, souffrir d’être à l’étroit, de manquer d’air : les trous dans le budget, la paperasserie, les rappels de factures qui ont rejoint spontanément le courrier indésirable… Au couvent, rien que le Silence, la Joie, le Chant. »
Mais elle a vécu, surtout, des révoltes qu’elle attribue par osmose psychologique à sa tante. La « petite sauvageonne » a grandi dans le féminisme. Elle s’insurge contre la domination des mâles qui s’immisce jusque dans la religion— si Dieu était une femme, n’est-ce pas les hommes qui se retrouveraient voilés ? L’emprise des prêtres sur les religieuses ne perpétue-t-elle pas une forme de patriarcat ? Aussi, quand son ami lui propose de l’épouser, elle répond : « Que tu m’épouses, Philippe ? Tu veux dire que nous nous mariions, j’espère. »
C’est à elle, d’abord, qu’elle pose les questions. Pourquoi se voiler ? Y a-t-il un besoin de se dématérialiser ? Un goût de l’uniforme ? Mais pour les hommes, l’uniforme démultiplie la virilité, c’est l’inverse pour une religieuse : « C’est le seul uniforme qui gomme la femme. » Qu’a-t-elle voulu gommer ? Pourquoi Agnès s’enfermait-elle ? Avait-elle peur ? Cela aussi réveille des souvenirs personnels. « Mes héroïnes favorites étaient la marâtre de Blanche-Neige et Cruella parce qu’elles m’effrayaient. » Mais qu’est-ce qui effrayait Agnès ? Et pourquoi, à vingt ans, quitter brusquement son fiancé ? Refus d’entrer dans le rôle d’épouse ? Au point de renoncer à la sensualité, quand on en garde les signes jusqu’à sa mort ? « On ne choisit pas la chasteté. Ça cache quelque chose. » Dans sa mémoire, un lien troublant unit des domaines pourtant si opposés : « J’apprenais les mots du sexe en même temps que ceux de la religion comme s’ils allaient de pair »
Alors la quête s’élargit auprès des tantes survivantes. Entre les mots, discrets, par des bribes de confidences, elle reconstitue une histoire tue. Un père trop tendre, mais jusqu’où, une mère morte, une sœur suicidée. Et d’étranges coïncidences qui finissent par constituer une responsabilité larvée, qu’Agnès n’a pu assumer. Tout cela constitue-t-il une histoire ? Dans sa tête, dans la tête du lecteur, peut-être. Mais rien ne peut être dit. « À toi de rassembler les morceaux »
Dans une écriture sobre, dépouillée, qui se permet exceptionnellement quelques belles images (« Des lys blancs explosent sur une marche près du cierge pascal »), Pascale Toussaint tente ici un portrait en diptyque, nièce et tante, dont on comprend d’emblée qu’il concerne toutes les femmes et tous les hommes conscients de ce qu’ils leur ont fait subir au nom de… Les points de suspension en disent plus long que les mots.
« Tout le monde sait bien qu’aucune femme n’a plus à se cacher les cheveux au nom de…
—Mais en quoi ça nous regarde ?
C’était la vie d’Agnès. »
Retour au sommaire
Flore Berlingen, Recyclage, le grand enfumage, Rue de l’Échiquier, 2021.

Pour rompre avec la société de consommation d’économie linéaire (produire, acheter, jeter), la fin du XXe siècle a inventé l’économie circulaire (produire, acheter, recycler). Était-ce une stratégie efficace ? Non, apparemment, puisque les écologistes prônent désormais une troisième voie, celle du réemploi : une politique de consignes de verre plutôt que de recyclage des plastiques, de réparation des objets plutôt que du recyclage de leurs matériaux.
Le recyclage aurait-il donc été un écran de fumée ? Peut-être. Il nous rassure sur le sort de nos déchets et nous encourage à rejeter (en triant) plutôt qu’à réparer ou réutiliser. Or la politique du recyclage a ses limites et ses pièges. C’est à leur analyse qu’est consacré ce livre. Le premier problème est l’impossibilité matérielle de recycler en totalité les emballages et produits que nous consommons. Pour certains, comme le polypropylène, parce qu’il n’existe pas de filière. Pour d’autres, comme le bois, parce que les filières sont surencombrées et que les matériaux recyclés ne trouvent pas preneurs. Pour d’autres encore parce que l’adjonction de nombreux additifs (colorants, opacifiants…) perturbe le tri.
Le deuxième problème tient à l’impossibilité de recycler à l’infini : dispersion des ressources (certains métaux se retrouvent en quantité infime dans les produits les plus divers, ce qui rend impossible leur collecte), imperfection des techniques (après quelques recyclages, le matériau n’a plus de valeur commerciale), impact négatif des techniques de recyclage (qui utilisent des chaleurs intenses, donc qui consomment de l’énergie)…
Le troisième problème naît d’une communication habile, qui donne l’impression au citoyen que tout fonctionne parfaitement. Un message « Pensez au tri ! » sur un emballage ne signifie pas qu’il soit recyclable, mais qu’on doit le jeter dans une poubelle à déchets ménagers. De même pour un logo assurant que l’on participe à l’économie circulaire, mais par un financement des éco-organismes et non par l’utilisation de produits recyclables. Conséquence : « le recyclage est devenu l’alibi et le débouché d’un modèle de production et de distribution mondialisé fondé sur l’usage unique. »
La solution ne viendra pas d’une baguette magique. Tout est à revoir dans le système actuel : l’organisation des filières, les soutiens publics au secteur, la communication… L’autrice appelle pour cela à une autorité de régulation aux pouvoirs étendus, des interdictions, des règles fiscales, l’adoption de standards qui permettraient d’optimiser le recyclage, la restriction des colorants ou opacifiants... Cela ne peut se faire que par une autorité politique forte et par une sensibilisation des consommateurs. Tel est le but de ce livre.
Son problème, c’est sans doute que ces derniers — nous — n’ont guère de moyen d’agir efficacement sur les causes, ni par le choix des produits, ni par l’élection d’un homme politique. Depuis que télévision et réseaux sociaux nous informent sur les étiquettes, on ne fait plus guère confiance aux logos dont on nous a appris à nous méfier — cela n’a pas conduit à les remplacer par des étiquettes plus honnêtes. On a également compris que les promesses du candidat Macron ne seraient pas tenues sur ce point. Et la pandémie de 2020 a donné un nouveau souffle au plastique et à l’usage unique, en particulier des milliards de masques… Que restait-il au consommateur pour tâcher d’inverser la tendance ? Le tri. Et voilà qu’on apprend qu’il est inefficace.
Retour au sommaire
Geneviève Damas, Jacky, Gallimard, 2021.
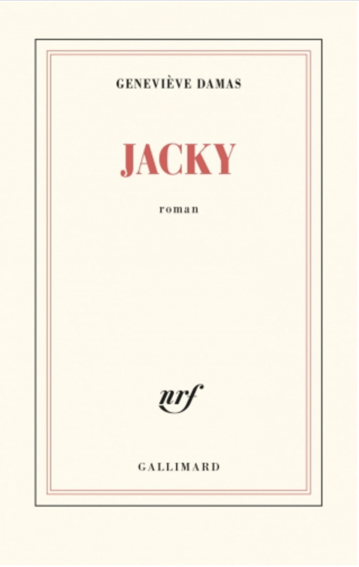
En 2018, Geneviève Damas a lancé avec deux autres romancières un atelier d’écriture dans trois écoles de confession différente. Cette initiative généreuse ne pouvait pas rester sans écho dans son œuvre romanesque. Il est question ici d’une rencontre entre des élèves d’une école juive et d’une école musulmane où chaque partie doit « éprouver sa tolérance ». Le premier malaise dissipé, deux adolescents se découvrent ; commence alors une histoire d’amitié absolue et salvatrice.
Bien sûr, l’autrice a exploité des situations extrêmes, des obstacles apparemment infranchissables entre les deux garçons. Le musulman est le fils d’un ouvrier et d’une infirmière ; le juif, d’un chef d’entreprise. L’un ressasse le sort des Palestiniens ; l’autre, les victimes de la Shoah. Celui-ci vit dans une famille généreuse et unie ; celui-là, dans un couple qui se déchire. Le premier a fugué à quinze ans pour aller combattre en Syrie, le second souffre d’une surprenante kleptomanie. Mais l’amitié est plus forte que ces oppositions parfois caricaturales. Leurs faiblesses (tous deux sont suivis par un psychologue ou un assistant judiciaire) deviennent leur force, des failles dans leurs certitudes qui permettent de comprendre autrui. Par l’écriture — l’atelier d’écriture, le mémoire de fin d’études, les graffitis sur les murs… — ils parviennent à analyser leurs sentiments et surmonter leurs préjugés pour envisager différemment leur avenir. Mais on devine déjà qu’ils ne parviendront pas à briser les préjugés de leur entourage.
Le principal problème de ce roman bien mené est sans doute de ne guère réserver de surprises. Tout y est attendu, des inévitables revers aux grands élans qui leur permettent de les surmonter. Dès la disparition du portefeuille d’Ibrahim, on comprend que Jacky l’a volé ; dès que ce dernier se dégage d’une agression, on devine que c’est pour aller chercher du renfort. On aimerait tant croire à cette amitié salutaire. Mais l’autrice veut tellement nous en convaincre qu’on n’y parvient pas vraiment.
Retour au sommaire
Emmanuelle Dourson, Si les dieux incendiaient le monde, Grasset, 2021.

Une famille déchirée sur trois générations, à la suite d’un « péché originel »… Il y a d’abord le grand-père, Jean, qui ajoute à la douleur morale la douleur physique d’une blessure à la jambe qui le cloue au lit. Il y a sa femme, Mona, narratrice intermittente, morte noyée dans un lac, mais dont l’âme inapaisée cherche à renouer les fils brisés : « la sangle de mon âme, détachée, et mon âme bientôt flottante errante, à la recherche de l’enfant perdu, mon âme enfin délestée mais que quelque chose rattachait encore à la terre — un reste d’humanité. »
Il y a surtout leurs deux filles, qui ont noué le drame : Clélia, qui tente de combattre le réchauffement climatique en reboisant l’Éthiopie, comme si son dévouement à une cause planétaire pouvait amenuiser sa responsabilité dans le déchirement de sa famille ; Albane, la pianiste prodige, qui a rompu avec les siens lorsque sa sœur lui a pris l’homme qu’elle aimait. Elle est partie pour l’Amérique quinze ans plus tôt, sur une réplique cinglante. Et donc, il y a Yvan, photographe pour des médias alternatifs, qui jadis a quitté Albane pour Clélia. De leurs quatre filles, seule Katia joue un rôle central dans le roman : elle n’apparaît d’abord que comme une adolescente désolée de ne pas voir pousser ses seins, et qui collectionne de dépit des soutien-gorge inutiles. Mais on se rend compte que sa lecture de l’Odyssée est la clé du récit. « Elle cherchait à introduire mon nom dans l’histoire », remarque Mona, l’âme en peine de sa grand-mère. Katia est fascinée par le mythe grec et suit Ulysse jusqu’au Tartare. « Il lui arrivait de penser que je rôdais encore, comme Anticlée, la mère d’Ulysse, prête à m’avancer jusqu’à la frontière, à quitter le pays des ombres si on m’évoquait, ou si on sacrifiait des bêtes pour que je vienne boire à la coupe des vivants. » Pourtant, la situation semble figée comme les eaux du lac.
Et voilà que l’Histoire se remet en marche. Albane, la pianiste de renommée internationale, revient en Europe pour un concert très médiatisé à Barcelone. Jean retrouve soudain son énergie pour aller écouter sa fille. Mona, l’âme errante, se trouve investie d’une mission. « J’allais retrouver les vivants. Les délier. » Un incident mineur — Jean se fait voler son portefeuille à Barcelone — oblige Clélia à entreprendre à son tour le voyage. Le concert d’Albane devient le théâtre des retrouvailles. Tous ces éléments, qui se dénouent en fin de roman, sont mis en place dès le départ : en les révélant, on ne trahit pas un récit qui se déroule comme une tragédie antique, dans la reconnaissance de son destin et dans son acceptation digne. De discret leitmotive en assurent la cohérence : la musique de Beethoven, les références à l’Odyssée, la couleur rouge… Le lecteur attentif suivra la transmission, de génération en génération, d’une robe rouge, qui rappelle la pourpre des magistrats, les nuances du maquillage… et le sang des sacrifices qui, dans l’Odyssée, « attire l’âme sans force des morts ». Cette Odyssée qui traverse tout le roman, apprise et récitée par la petite-fille, et peut-être murmurée par les arbres. La déchirure à l’origine du drame, l’enlèvement d’Yvan par Clélia, n’évoque-t-elle pas l’enlèvement d’Hélène ? On songe aussi au mythe de Perceval, au vieux roi blessé et à l’innocent qui pose la bonne question. Comme dans le mythe du Graal, l’infirmité physique répond à la déchéance mentale. L’enfant parti génère une blessure inguérissable, la rupture amoureuse laisse une cicatrice agaçante.
Le roman joue en permanence sur ces confusions de niveaux de conscience : entre rêve et réalité, passé et présent, morts et vivants, corporel et spirituel, imagination et sensation, particulier et général… Le grand-père immobile voyage par l’imagination, un tableau vibre sous le regard de celui qui l’aime, l’énergie de la femme de ménage est comme un génie caché dans le placard… La plus stimulante de ces superpositions d’imaginaires est sans doute celle du drame cosmique et du drame familial. La hantise de l’apocalypse et du réchauffement climatique traverse le récit, mais traduit aussi l’état moral des personnages. « Ma fille était une terre sèche à inonder, un ciel à embraser. Elle se tenait dans le réel comme dans une eau tiède où seul ce qui palpitait au bout de ses nerfs était sûr. » L’angoisse de la fin des temps s’entremêle tout naturellement à une fascination pour l’origine du monde — au sens propre comme au sens désormais symbolique que lui a donné le tableau de Courbet : le sexe féminin et ses troublants mystères. Le titre, qui fait allusion à un vers de Jacottet (« Si les dieux incendiaient le monde »), sonne à la fois comme une menace et un espoir. Car si la rencontre de Barcelone parvient à conjurer les quinze ans de déchirement familial, tout redevient possible. Il suffit que marche le paralytique, que la musique arrache les morts au Tartare.
Parfois déroutant, par l’accumulation des prénoms féminin en –a que le lecteur met un peu de temps à maîtriser, le roman se construit par touches pointillistes minutieusement cernées : « quelque chose d’imperceptible avait ourlé les paupières de Jean », un moment d’ébriété musicale, un froissement de l’humanité sur les trottoirs, des frôlements de fourrures dans les taillis, des conversation hérissée de cris, des cheminées de silence dans l’œil du cyclone, ou l’impression de dévaler les marches d’un escalier donnant sous la mer… Il faut s’y abandonner, car (outre leur évocation poétique) c’est dans le minuscule que se révèle l’infini. Une mouche ne finit-elle pas par dévoiler le secret de Beethoven ? Et de ces échappées d’infini naissent de subreptices extases : « ensemble, ils auraient… agrandi l’espace de la chair, du désordre salutaire, leur pulsion de vie aurait dissous toutes les règles. Leur corps se serait élargi aux dimensions de l’univers. » Ainsi se prépare la somptueuse scène du concert, qui sert de point d’orgue à une construction symphonique parfaitement maîtrisée.
Car ce premier roman se révèle d’une surprenante maturité, dans son écriture, dans sa réflexion, dans sa construction complexe autour d’un axe solide, dans les somptueuses évocations de la douleur, du pays des morts. Le lyrisme de bon aloi — quoique certaines formules, parfois, peuvent sembler à la limite du maniérisme (« comment le monde pouvait-il devenir si sinistre une fois tiré sur lui le voile du crépuscule ? ») — comme l’impressionnisme des notations rompent avec bonheur avec la sécheresse d’écriture que la fin du XXe siècle avait imposée au roman.
Retour au sommaire
Florence Aubenas, L’inconnu de la poste, Éditions de l’Olivier, 2021

Le 19 décembre 2008, un meurtre sauvage est commis dans une bourgade de l’Ain, Montréal-la-Cluse. La victime, Catherine Burgod, postière, est tuée de vingt-huit coups de couteau. Un fait divers sordide, mais pas de quoi titiller un grand reporter de Libération, du Monde et du Nouvel Observateur, au point de lui consacrer sept ans d’enquête ! Mais les personnalités en cause ne sont pas banales. La victime, dépressive, a déjà manqué tant de suicides qu’on pense d’abord qu’elle a réussi le dernier — mais avec vingt-huit coups de couteau, dont six mortels, l’hypothèse ne tient guère. Et puis, il y a Gérald Thomassin, le suspect pas vraiment numéro un, puisqu’il a fallu cinq ans pour remonter jusqu’à lui, alors qu’il habitait en face de la Poste. Et là, on a tiré le gros lot. Ce jeune acteur, qui à trente-quatre a déjà tourné une quinzaine de films, s’est peu à peu déclassé sous l’emprise de la drogue et de l’alcool. Soupçonné, emprisonné, relâché pour retard dans la procédure, il semble mis hors de cause par une analyse ADN impliquant un autre suspect, mais, le jour de la confrontation… il disparaît. Thomassin a encore des relations dans le milieu du cinéma. Grâce à Béatrice Dalle, il est défendu par Éric Dupond-Moretti, pas encore ministre de la Justice, mais déjà basse profonde du barreau. Cette fois, tous les éléments y sont.
Au-delà de l’enquête journalistique classique, l’ambition de Florence Aubenas est de faire revivre cette France que l’on dit profonde parce qu’elle échappe à l’écume de l’actualité, mais où souvent les préjugés et les clichés prennent le pas sur la profondeur du jugement. Dans un pays où tout le monde se fréquente depuis l’enfance, les hypothèses vont bon train. « Ici, la vie coule, transparente comme un verre d’eau. On sait qui travaille où, dans quelle boîte, à quels horaires. Les déplacements, les regards, les conversations, tout se croise. Même sans y prêter garde, les mouvements se remarquent aux fenêtres qui s’allument, aux voitures qui circulent. » Tout se sait, ici : « vingt-quatre fenêtres ont une vue directe sur l’unique entrée de la poste ». Alors les témoignages se bousculent. On sait tout, sauf le principal. Ça en deviendrait comique s’il n’y avait ce crime atroce.
L’enquête, écrite dans un style journalistique habile à susciter l’intérêt pour ce qui n’en a pas, ne parvient guère à faire prendre la mayonnaise malgré l’exceptionnelle richesse de tous les éléments. Parfois, des notations juxtaposées, des phrases elliptiques tentent d’accélérer le rythme : « Il lui tend ses papiers. 33 ans, 1m 70, 52 kilos. Domicilié à Rochefort. » — « C’est lui. Lui, son mari. » Dans d’autres passages, l’accumulation des clichés tente de rendre pittoresque un paysage d’une parfaite banalité : les barques se dandinent sur l’eau, la plage est au creux d’une anse, les dames y déploient leur serviette et bataillent avec les touristes. Les maisons sont perchées, le brouillard moutonne, la route est poudrée de neige et des coulées de mousse envahissent les chemins. « Quoi d’autre ? Rien. » Si l’on parle, on adopte un ton faussement relâché, et le refus des inversions dans les incises tente d’instaurer une complicité avec le lecteur : « “Mon fief”, il a décrété. » « “L’endroit est maudit”, ils disent. » Tout cela est-il convaincant ? Sûrement, car « dans l’Ain, on retombe vite sur son cul quand on veut faire le malin. » Certes, disait Pascal, « qui veut faire l’ange fait la bête », mais celui qui fait la bête… fait aussi la bête.
Retour au sommaire
Stéphane Héaume, Sœurs de sable, Rivages, 2021.

Soixante ans séparent l’histoire de Rose St Just, en 1958, et celle d’Amélia
ini, en 2018. Leurs destins, entrecroisés de chapitre en chapitre, semblent sans rapport. Mais dès le titre, nous comprenons qu’elles sont « sœurs de sable ». Sable de la plage, sans doute, où se sont éveillés les désirs, sable de la piste de cirque, sable surtout qui s’écoule comme le temps dans le sablier de la vie, « ce sable qui avait été porteur de désir et qui aujourd’hui l’aspirait comme il avait aspiré le temps ». Le roman aux deux histoires devient métaphoriquement un sablier à deux réservoirs entre lesquels s’écoule le sable du récit et des décennies.
1958, donc. Rose St Just vient d’accepter l’« héritage empoisonné » d’un oncle d’Amérique : un hôtel de luxe à Portfou, station balnéaire naguère huppée, mais en perte de vitesse. Peut-être par « esprit de compétition » avec sa sœur Liz, qui de son côté hérite d’une villa. Mais Liz a de l’argent, Rose n’a pas les moyens d’entretenir l’hôtel. Leurs relations, qui semblent au départ empoisonnées par la rancœur et la jalousie, se révélera au fur et à mesure bien plus complexe. Elles aussi, sœurs de sable, mais de ce sable qui s’effrite ? On peut aussi le penser...
Faute de famille, Rose a rassemblé dans sa chambre des portraits dénichés un peu partout dans l’hôtel, à commencer par un troublant jeune homme dans une robe de chambre écarlate, une copie du portrait de Samuel Pozzi par John Singer Sargent. Et voilà que débarque un tout aussi troublant jeune homme, mais sans robe de chambre écarlate, le trapéziste d’un cirque de passage qui se fait dorer au soleil sous le regard de Rose. Coup de foudre ? Ou à nouveau rivalité inavouée avec Liz, qui elle aussi est séduite par le jeune homme ?
2018. Amélia Lambertini, chroniqueuse dans un magazine féminin, se prend de sympathie pour un voisin nonagénaire dont on comprend vite qu’il a connu Rose, soixante ans plus tôt. Intriguée, la journaliste décide d’offrir à son voisin la surprise d’un retour à Portfou, sans se douter qu’elle enclenche un dangereux engrenage. La suite appartient au lecteur…
L’intelligence du récit est d’avoir travaillé sur les contrepoints plus que sur les ressemblances entre les « sœurs de sable » et les situations. Une des histoires se situe dans un hiver neigeux et dans un dirigeable pris dans une tempête ; l’autre, durant un été caniculaire dans un hôtel abandonné, immobile comme un vaisseau échoué. Amélia vient en aide à un vieil homme en détresse ; Rose, au fond du gouffre, est aidée par un vieil homme qui relève le défi de faire revivre la station balnéaire et son hôtel. L’une fuit les mondanités, l’autre y semble à l’aise. Mais de part et d’autre, on croise des imposteurs ; de part et d’autre, le crime est la seule porte de sortie qui s’offre à leurs victimes. Thèmes et contre-thèmes se combinent comme dans une fugue, avec de discrets leitmotive, comme ce briquet aux initiales T.C. qui fait le lien entre les époques, ou ce « Hollandais volant » qui, derrière la métaphore, adresse un clin d’œil à un jeune trapéziste.
Dans une langue très fluide, qui alterne selon les époques les rythmes amples de la prose classique et le staccato de l’écriture moderne, Stéphane Héaume excelle à croquer des personnages pittoresques, amicaux ou perfides, enjôleurs ou à fleur de nerfs… La précision du vocabulaire, les petites touches de notations pointillistes, l’envoûtement des adjectifs, se prêtent aux ambiances contradictoires de la vie mondaine ou de l’émotion solitaire. Ici, l’évocation d’un nageur dégage une sensualité troublante — « ces vaguelettes qu’il embrasse du menton, la résistance de l’eau que ses bras défont à chaque fois qu’il les ouvre, la courbe scintillante de la baie étoilée de maisons blanches ». Là, les paillettes des mondanités scintillent de leur éclat trompeur — « fuir la peine capitale de la conversation mondaine, du paraître, de ce jeu d’escrime où le langage tient lien de fleuret, l’hypocrisie de masque, sans vainqueur proclamé mais promis à des joutes éternellement recommencées ». Ouvert sur la reproduction d’une partition de Franz Schreker, refermé sur celle d’un tableau de John Singer Sargent, le roman tient à la fois de la composition musicale et de l’hommage pictural. Le Concerto pour Apollon qui donne son titre à la partie centrale pourrait en être une clé d’interprétation.
On retrouve dans ce nouveau roman les atmosphères chères à l’auteur, le jeu d’une séduction qui se rit des différences d’âge, le miroir pictural ou musical du récit, les lieux publics au luxe défraîchi, le lyrisme teinté d’un arrière-goût amer qu’il cultive depuis Le Clos Lothar, et jusqu’à ce clin d’œil final faisant de l’auteur le témoin privilégié de l’histoire qu’il raconte, déjà présent dans Dernière valse à Venise.
Voir aussi : Dernière valse à Venise.
Retour au sommaire
Rose-Marie François, Au soleil la nuit, maelstrÖm, 2021.

Été 1969 : deux amies de faculté prennent séparément leurs vacances. L’une, Marie-Anne, part donner un concert à travers le Sahara ; l’autre, Marie-Jeanne, parcourt la Suède dans l’attente de cours qu’elle suivra à Uppsala. Mais celle-ci se noie dans le lac où sa voiture est tombée. Björn, un jeune homme qu’elle avait pris en auto-stop, conserve des séquelles de l’accident. Le roman s’ouvre sur la visite d’un enquêteur, Pär Håkansson, chargé par une compagnie d’assurance de voir si le rescapé n’aurait pas droit à une indemnité pour coups et blessures volontaires. S’agissait-il bien d’un accident ? Marie-Jeanne n’a-t-elle pas entraîné une victime innocente dans un suicide ? La responsabilité de la famille pourrait-elle être invoquée ?
La question rebondit d’abord sur l’ambiguïté de la dernière lettre reçue par Marie-Anne : « Là, c’est la fin du monde ou la fin d’une vie. Ou alors, peut-être, le commencement d’une autre vie. » La fin ? Le commencement ? Que va-t-on choisir de lire ? Tout se complique à la lecture des nouvelles qu’écrivait la disparue. Des nouvelles fantastiques, mais qui peuvent sembler prémonitoires, puisqu’il y est déjà question d’une voiture tombant dans un lac. Où de l’abandon au désert, autre forme de suicide. Ces curieuses mises en abyme ne manquent pas de retenir l’attention de l’enquêteur, mais aussi du lecteur. C’est sans conteste la partie la plus convaincante de ce roman construit comme un mille-feuille.
L’enquête prend alors une autre tournure. Elle a commencé dans la belle-famille de Marie-Jeanne, une famille odieuse, qui lui a mené la vie rude, fière de ses jeux de mots idiots et de ses préjugés misogynes. On comprend peu à peu l’évasion en Suède et le double sens de la formule, la fin d’une vie ou le commencement d’une autre. L’enquête se poursuit chez Marie-Anne et dans les nouvelles dont elle est dépositaire. L’interrogation alors s’élargit, sur la personnalité de Marie-Jeanne, sur des drames plus profonds, une dépression, les craintes de la grossesse, la conciliation entre maternité et vie professionnelle, la peur de vieillir… « Nous vieillirons. Nous n’aurons pas tous un lac pour nous en empêcher. »
Surtout, la lecture attentive des textes laissés par Marie-Jeanne pose de nouvelles questions qui estompent les frontières entre fiction et réalité. Faut-il s’attacher aux passages en italiques ? Ils sont écrits à la troisième personne, à la différence des récits à la première — « Marie-Jeanne raconte deux fois la même chose. À la première personne, la réalité. À la troisième, la… oui, la vérité, pourrait-on dire. »… Quant aux passages biffés, ne disaient-ils pas quelque chose de plus important ? « Ce que l’on barre en écrivant, c’est peut-être ce que l’on omet quand on raconte un rêve : l’essentiel ? » L’interrogation dépasse d’ailleurs le cas de Marie-Jeanne. « Peut-on faire de la fiction sans parler de soi ? » C’est la question de fond de ce roman, qui commence par la formule classique (« Ce roman est une pure fiction. Toute ressemblance des personnages avec des personnes existant ou ayant existé est tout à fait fortuite »), mais qui joue sur l’effet de réel, mêlant à la narration des articles de journaux ou des photos prises par l’autrice ! On s’aperçoit alors que la formule initiale (et désuète) fait partie du piège qu’elle nous tend.
Malicieuse, Rose-Marie François, après avoir raillé le goût de la belle-famille pour les jeux de mots idiots, en introduit de plus subtils pour dérouter son lecteur. Le prénom de l’enquêteur amusait la belle-mère — Pär était-il père ou faisait-il la paire ? Mais on se demandera plus sérieusement s’il n’est pas un Pärsonnage. Quant à Marie-Jeanne et Marie-Anne, on remarquera vite qu’entre elles, il manque le « je ». Celui du narrateur ? De l’autrice ? Du lecteur ? Des trois, peut-être…
Ainsi se préparent des coups de théâtre successifs, des substitutions en miroir qui achèvent de déconcerter le lecteur : s’agit-il d’un retournement de la situation ou d’une ruse de l’enquêteur ? Marie-Jeanne est-elle vraiment morte ? Mais de quelle mort ? L’ambiguïté de la dernière lettre — la fin d’une vie ou le début d’une nouvelle — prend alors tout son sens. On se rend compte que les nouvelles intégrées au roman étaient plus prémonitoires que ce que l’on croyait — la réapparition d’une morte dans une nouvelle fantastique, la similitude symbolique entre le lac et le désert… Et que les discussions linguistiques (par exemple, sur l’inversion en français !) ne sont pas des digressions gratuites. Ce qui semblait au départ une simple enquête policière révèle une construction ingénieuse qui ravira le lecteur attentif.
Retour au sommaire
Gérald Bronner, Apocalypse cognitive, P.U.F., 2021.
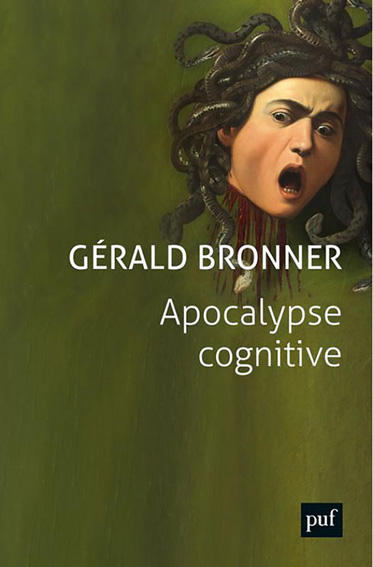
« En France, on n’a pas de pétrole, mais on a des idées », disait un slogan lancé par Valéry Giscard d’Estaing pour promouvoir l’heure d’été. Et l’humanité jouit au XXIe siècle d’un capital immatériel bien plus considérable, le « trésor le plus précieux du monde », nous promet Gérald Bronner. De quoi s’agit-il ? Du temps de cerveau disponible. Si celui-ci fut discrédité naguère par Patrick Le Lay, alors P.D.-G. de TF1, qui se targuait de le vendre à Coca-Cola, il ne s’agit pas d’une formule creuse. Il peut même se calculer, en décomptant le temps de travail du temps que nous passons éveillé. Et que constatons-nous ? La disponibilité de notre cerveau serait aujourd’hui de 89 %, alors qu’elle n’était que de 52 % en 1800 ! En laissant les machines, puis l’ordinateur, prendre en charge les tâches simples, répétitives, qui ne sont pas à la hauteur des « formidables potentialités » de notre cerveau, l’homme s’est doté de « prothèses cognitives » qui dégagent du temps libre. Conséquence : la France dispose désormais d’un capital d’un milliard six cent trente-neuf millions d’années de temps de cerveau disponible, contre cinquante-huit millions d’années en 1800 ! Quand je vous disais que cela se calculait…
À cette première libération s’en ajoute une seconde, tout aussi importante : notre cerveau s’est affranchi de la pensée animiste, de la magie, de la religion, pour s’ouvrir à une explication rationnelle du monde. Ainsi avons-nous pu progresser à pas de géants et pourrions-nous relever le plus formidable défi qui se pose à notre civilisation : la sauver. Certaines tâches en effet resteront longtemps impossibles à l’intelligence artificielle et nécessiter celle de l’homme. En particulier celle d’« explorer l’univers des possibles lorsque cet univers n’a pas déjà été circonvenu » : inutile de demander à un ordinateur d’imaginer une solution à un problème dont les éléments ne peuvent être encodés. Spécifiquement humaine, aussi, la capacité d’isoler un signal et à le considérer comme un événement. Cette capacité, familièrement baptisée « l’effet cocktail », permet de distinguer l’essentiel de l’accessoire : dans le brouhaha d’un cocktail, seul un cerveau humain est capable de se concentrer sur une conversation. Faculté capitale devant la masse d’informations désormais accessible.
Mais ce qui fait notre force peut aussi faire notre faiblesse. En nous concentrant sur une tâche précise — sur la conversation dans un cocktail — nous entrons dans un « tunnel attentionnel » qui nous empêche de percevoir le reste du monde. Tel est bien le but, sans doute, mais si un danger inattendu survient, il faut savoir s’en préserver. C’est ce qu’on appelle « l’expérience du gorille invisible » : des sujets focalisés sur un exercice à résoudre ne voient pas qu’un gorille a traversé la pièce ! Pour contrer ce revers, le cerveau s’est donc doté d’un autre instrument, « l’effet pop-up » : certains déclics s’opèrent quand un mot est prononcé, quand un certain type d’événement se présente, comme une fenêtre qui s’ouvrirait soudain dans le tunnel attentionnel. Par exemple, notre attention sera attirée dès que l’on prononce notre prénom dans le brouhaha. Il y a donc des objets privilégiés qui capturent notre attention même si elle est tout entière tourne vers un autre sujet de réflexion : tel est notre prénom, mais aussi une information constituant un danger (la couleur rouge, par exemple, qui évoque le sang), ou, tout simplement, le mot « sexe », qui nous fait relever la tête dès qu’il est prononcé…
Ces réflexes se sont lentement constitués au cours des millénaires et correspondent à des instincts préhistoriques restés enfouis en nous : le sexe, la peur, la curiosité pour une situation violente (une dispute, un clash)... Question de survie. La sélection naturelle a favorisé les individus les plus sensibles aux alarmes ; être sensible aux conflits permet de les éviter… Tout est donc parfaitement normal, ou du moins explicable. Mais ce qui était vital hier est devenu encombrant aujourd’hui. Inutile, souvent, dans un monde largement sécurisé. La surestimation des risques, en soit, n’est pas dangereuse. Sinon qu’elle mobilise notre disponibilité mentale. Un peu. Beaucoup. Excessivement.
Car ces informations parasites finissent par constituer l’essentiel de notre « marché cognitif ». Une masse cyclopéenne où il devient difficile de se retrouver, d’autant qu’elle est alimentée, à travers les réseaux sociaux, par les réactions ou les questions de chacun d’entre nous. Cette dérégulation et la « cacophonie cognitive » ne seraient pas dramatiques si chacun pouvait faire le tri de l’essentiel et de l’accessoire par son esprit critique. Ce n’est hélas pas le cas : la concurrence de l’information pousse au contraire ses producteurs à miser sur nos réflexes primitifs plus que sur notre intelligence analytique. Il est plus efficace de capter notre attention en sollicitant les instincts préhistoriques — le sexe, la peur, l’indignation, la curiosité, qui restent de « bons supports émotionnels pour conférer une certaine viralité à un produit cognitif »… Question vitale pour les médias traditionnels, qui ont besoin de ventes (ou de clics) pour survivre.
Or ces intermédiaires ont une fonction principale dans le traitement de l’information. Il s’agit moins de la diffuser que d’éditorialiser le monde : focaliser l’attention du lecteur sur tel élément du réel plutôt que sur tel autre. Telle était jadis la mission des gate keepers, ces « gardiens des portes » que sont les journalistes, universitaires, syndicalistes, guides spirituels, hommes politiques… Cette gestion verticale du marché cognitif, qui privilégie l’offre sur la demande, n’est plus de mise. Aujourd’hui, à l’inverse, l’offre s’indexe sur la demande : les gate keepers s’alignent sur ce que leur public attend d’eux. Les médias ne survivent plus que par les ressources publicitaires et doivent affronter une « sélection par la concurrence attentionnelle ». La captation de notre attention ne dépend dès lors plus de la qualité de l’information, mais de la satisfaction mentale que produisent les effets cognitifs. Or rétablir la vérité exige un effort mental plus conséquent que croire à une fake new. Par manque de disponibilité intellectuelle, nous préférons souvent croire sans vérifier. Tel est (pour le dire crûment) le « principe d’asymétrie du bullshit »… Une connerie (bullshit) prend moins de temps que sa réfutation. Le mandat de Donald Trump nous a prouvé que la bataille de l’attention est désormais plus importante que la bataille de la conviction.
Conséquence ? D’une part, une nouvelle concurrence entre croyances et pensée. Si l’on croyait révolu le temps où la religion pouvait condamner la science, il est curieux de voir que ce qui sollicite nos croyances (fake news, théories du complot, indignations…) prend le pas sur les analyses rationnelles. D’autre part, notre précieux temps de cerveau disponible est inutilement dépensé à nous prémunir contre des dangers infondés, ou, parfois, pour affronter des complications nouvelles (lire un texte en « écriture inclusive » prend par exemple beaucoup plus de temps). Lorsque de véritables problèmes apparaissent, notre action peut s’en trouver paralysée. L’exemple classique est celui des antibiotiques : devant la peur largement exagérée du « microbe », on préfère se protéger illusoirement sans comprendre que nous participons ainsi à la baisse de l’efficacité des antibiotiques.
Une comparaison avec la surconsommation de sucre est tout aussi éclairante pour comprendre ce processus : durant le Pléistocène, nos ancêtres ont sans doute tiré avantage des aliments sucrés qui leur fournissaient des réserves d’énergie disponibles rapidement et pouvaient les sauver en cas de danger. Cette appétence pour le sucre s’est développée dans notre cerveau par des circuits de récompense à court terme, qui procurent un plaisir facile en libérant de la dopamine. Mais dans un monde où le danger a été limité par le développement de la vie sociale, cette appétence pour le sucre devient dangereuse : les sucres s’accumulent pathologiquement. Trop tard : notre cerveau s’est shooté à la dopamine. Il en va de même pour les autres réflexes préhistoriques, la curiosité, la peur ou la sexualité. Or la recherche du plaisir (qui dépend de la dopamine) n’a rien à voir avec celle du bonheur (qui dépend de sa sérotonine). Et le monde contemporain joue plutôt sur les circuits cours du plaisir : les likes, les notifications, l’enchaînement des vidéos… sollicitent une réaction immédiate qui, souvent, nous flatte sur l’instant et nous laissent à long terme sur notre faim. Telle est aujourd’hui la consommation d’information : une accumulation de petits événements qui flattent nos instincts préhistoriques mais qui ne laissent plus de temps pour digérer des nourritures consistantes. Les écrans (télévision, tablette, smartphone, ordinateur…) contribuent à cette captation de l’attention qui dilapide notre « précieux trésor ».
Sans doute s’agit-il là du plus grave danger que rencontre notre époque dans le domaine de l’information. Il se trouve par ailleurs accentué par d’autres phénomène que Gérald Bronner analyse minutieusement. L’anonymat des réseaux sociaux, par exemple, qui réveille les instincts les plus obscurs. L’hyper-conséquentialisme de la nouvelle morale, qui ne déduit plus la culpabilité de l’intention, mais des conséquences de l’acte, même involontaires — une œuvre d’art dénonçant le racisme peut paradoxalement choquer par ses représentations des situations qu’elle dénonce et sera elle-même condamnée. Mais aussi l’évolution des sensibilités, qui affine les critères de réaction : si la violence a objectivement diminué tout le long de l’histoire, on peut avoir l’impression qu’elle augmente, car notre conception de la violence évolue. Le réflexe de se comparer aux autres fausse aussi notre jugement : celui qui a remporté une médaille d’argent s’estime étrangement plus malheureux que celui qui a reçu la médaille de bronze, car le premier regrette de n’avoir pas la médaille d’or et le second est heureux de monter sur le podium. Tous ces phénomènes, non contents de biaiser l’analyse, renforcent le sentiment d’être victime du système, la frustration générale, la colère contre les « élites ». Dans un monde de transparence, la comparaison avec le sort des autres devient permanente et est entretenue par les médias.
Voilà l’apocalypse cognitive qui donne son titre à cet essai. Le terme n’est pas à prendre dans son sens courant de « catastrophe », mais au sens premier de « révélation ». La dérégulation du marché cognitif a révélé les grands invariants de l’espèce, qui restaient présents de façon larvée dans notre cerveau, sous forme de potentialité, et qui remontent à la surface : le sexe, la peur, la colère… Cela nous oblige à nous regarder en face, tel que nous sommes, avec des capacités inégalées d’intelligence et de créativité, avec un temps de cerveau disponible en expansion fulgurante, mais aussi avec des réflexes primitifs qui gaspillent ce précieux trésor.
Tel est le constat. Comment l’interpréter ? Outre la misanthropie (« tel est le monde d’aujourd’hui, il n’y a qu’à le mépriser et le haïr »), qui ne mène à rien, Gérald Bronner distingue deux types de réactions : le néo-populisme et la théorie de l’homme dénaturé. Le premier, loin de craindre cette « apocalypse cognitive », s’en réjouit et donne toute sa légitimité aux invariants mentaux qu’elle nous révèle. Il y voit une libération des contraintes imposées jusqu’ici au « peuple » par « l’élite dominatrice » et prône la transparence et la démocratie participative. Cette « démagogie cognitive » ne fait qu’accélérer le processus délétère. Les exemples récents de Donald Trump ou du Brexit illustrent bien cette démarche.
La théorie de l’homme dénaturé considère à l’inverse que l’homme, né bon selon la formule attribuée à Rousseau, a été dénaturé par le marché, le capitalisme, la logique consumériste, la modernité... Toutes les observations analysées dans ce livre ne seraient dès lors que des éléments accidentels et non des propriétés essentielles de l’humanité. Cette thèse, qui flatte notre ego (« nous valons mieux que ça ») et qui porte un grand espoir (le monde est malléable, on peut tout changer), empêche, selon l’auteur, de prendre conscience des invariants de l’humanité et d’en tenir compte dans notre appréhension du monde.
Entre ces deux tendances qui ont en commun de nous « aveugler sur le sens à tirer de l’apocalypse cognitive », l’auteur appelle à une troisième voie : « il convient de créer un espace narratif et analytique entre ces deux pentes. » Il y a urgence, car notre civilisation, que, depuis un siècle, nous savons mortelle, atteint son « plafond ». « On peut prendre le pari que cet obstacle peut être franchi », mais il ne peut l’être qu’en utilisant cet inestimable trésor de notre temps de cerveau disponible. À le dilapider en tâches récréatives, en réactivations d’instincts préhistoriques, en peurs irrationnelles, nous « perdons des chances de franchir le plafond civilisationnel ». Déjà, les études montrent que chez les jeunes — en charge de construire le monde de demain — le temps d’attention a baissé de 35 % par rapport à la génération qui les précède. Il est urgent donc de prendre en compte les invariants humains révélés par cette « apocalypse cognitive », sans les sanctifier (comme les populistes) ni les nier (comme les tenants d’une dénaturation de l’homme), mais pour pouvoir jouer sur les deux leviers de l’action humaine : les récompenses à court terme (levier de la création) et la planification stratégique (levier de l’analyse). Telle devrait être la priorité de notre civilisation. « Nous sommes loin de pouvoir imaginer tous ces dangers, et plus encore de leur opposer des réponses. Mais celles-ci existent potentiellement dans le trésor de notre temps de cerveau disponible. »
Au-delà de cette analyse par bien des points convaincante et de cet appel à prendre en main le sort de notre civilisation, on aurait sans doute aimé une ouverture plus concrète sur cette « troisième voie » préconisée et sur les moyens de faire face au défi que ce livre nous lance. Mais l’optimisme n’est pas plus de mise que le pessimisme : « Rien n’est joué, mais les dés sont pipés. » À chacun de se ranger, selon ses convictions, parmi ceux qui baissent les bras ou appellent au sursaut.
Voir aussi : La démocratie des crédules. Comme des dieux.
Retour au sommaire
Jacqueline Lalouette, Les statues de la discorde, Passés/composés, 2021
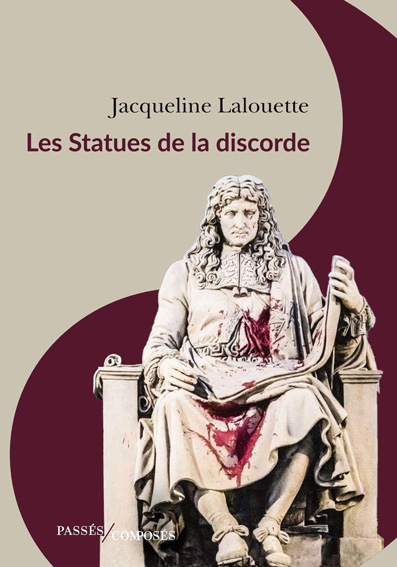
Durant l’été 2020, un « épisode iconoclaste » a frappé la France comme nombre de pays, essentiellement de culture anglo-saxonne. Après l’assassinat de George Floyd, et dans la ligne du mouvement Black Lives Matter, des centaines de statues ont été déboulonnées, brisées, peinturlurées… Toutes ont un lien réel ou supposé avec l’histoire du colonialisme. On ne peut nier un lien direct entre cette déferlante et les événements américains, mais pour autant, il ne s’agit pas d’une nouveauté absolue. En recensant ces cas de vandalismes et en analysant les principaux, l’historienne Jacqueline Lalouette met en évidence des particularités locales, l’antériorité de certaines pratiques, des paradoxes surprenants… Cela amène à « relativiser cette concomitance » entre la vague de déboulonnage et la mort de George Floyd.
Bien sûr, on pense tout de suite au vandalisme révolutionnaire et aux protestants iconoclastes, mais plus près de nous, la déferlante de 2020 avait été annoncée par des actions ponctuelles : la statue de Christophe Colomb à Boston avait déjà été décapitée en 2006, celle de Victor Shœlcher de Rivière-Pilote avait été barbouillée en 1971… La différence, c’est la brusque multiplication de ces actions et la contagion mondiale qu’elles connaissent aussitôt : plus de cent statues aux USA, une liste de 80 statues établie en Grande-Bretagne, des cas recensés en Belgique, aux Pays-Bas, au Danemark, en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Portugal, dans plusieurs pays d’Afrique ou du Pacifique…
L’histoire particulière (mais souvent simplifiée, voire légendaire) des personnages déboulonnés peut expliquer ces mouvements de colère. Joséphine de Beauharnais, issue d’une famille de planteur, aurait convaincu Napoléon de signer le décret réintroduisant l’esclavage aboli à la Révolution. Mahé de La Bourdonnais réalisa certes de grands travaux à la Réunion, mais en achetant des esclaves et en pourchassant cruellement les Nègres marrons. Le général Leclerc (le beau-frère de Napoléon, non celui de la Libération !) prônait l’extermination des Noirs, hommes et femmes, au-dessus de douze ans. Certains, qui éveillent plutôt des échos positifs dans la mémoire collective, ont aussi leur face sombre. Paul Bert, célébré pour avoir fondé avec Jules Ferry l’instruction publique gratuite et obligatoire, fut aussi un théoricien de la hiérarchie des races. Et certaines des personnalités visées témoignent surtout de l’ignorance de leur époque. S’en prendre à Victor Hugo peut ainsi paraître surprenant, mais il a bel et bien répandu l’idée selon laquelle l’Afrique était une terre vide que les Blancs pouvaient coloniser. Quant aux missionnaires, ils peuvent être célébrés par l’Église catholique et être considérés par les peuples qu’ils ont convertis comme les acteurs d’un véritable génocide culturel : ainsi les statues de Junipero Serra, un franciscain canonisé par le pape François en 2015, sont-elles abattues en 2020 !
On a pu s’étonner de certaines victimes, comme Victor Schœlcher, figure marquante de l’abolition de l’esclavage et déboulonnés par les descendants de ceux qu’il avait fait libérer. Cela vaut la peine, alors, de rappeler l’histoire du mouvement abolitionniste et les arguments des acteurs de ces destructions. Certes, le décret d’abolition date bien du 27 avril 1848, mais le temps de la publication et du voyage, il n’arriva en Martinique que le 3 juin, et ne devait entrer en application que deux mois plus tard ! Entretemps, dans l’ébullition des débats parlementaires et devant l’impatience de leur aboutissement, des émeutes y avait éclaté, entraînant la démission du maire de Saint-Pierre et l’abolition de l’esclavage par le gouverneur de l’île, le 22 mai. L’abolition officielle, deux mois et demi plus tard, a semblé un camouflet aux Martiniquais, qui soutiennent depuis qu’ils se sont libérés eux-mêmes. Le culte de Schœlcher peut à juste titre passer pour un récit national biaisé visant à déculpabiliser la France de sa responsabilité historique. Si l’on ajoute à cela la domination économique des colons sur les esclaves noirs affranchis et leurs descendants, on peut comprendre l’exaspération qui se traduit par le déboulonnage des statues.
Au fil des exemples réunis et commentés par Jacqueline Lalouette, on s’étonnera (ou non !) de trouver Jules César (parce qu’il aurait méprisé les Belges dans la Guerre des Gaules), Gandhi, la petite sirène de Copenhague, ou Jacques Cœur, grand argentier de Charles VII, qui fut effectivement armateur, mais au XVe siècle, bien avant la traite des esclaves. Parmi les malentendus les plus spectaculaires, on se rappelle les attaques contre Colbert, fustigé pour voir été l’auteur du Code Noir. Un épisode qu’il convient de contextualiser. S’il a bien été à l’initiative d’un code rassemblant et examinant les règlements relatifs aux esclaves, le ministre de Louis XIV était mort avant sa proclamation, et c’est… son fils qui le signa. La cruauté des peines prévues dans ce code se retrouve d’ailleurs dans les châtiments corporels appliqués aux militaires ou aux marins et ne peut être présentée comme un acte discriminatoire visant exclusivement les Noirs. Le but de ce code (comme de tous ceux édictés sous Louis XIV) semble au contraire avoir été de limiter le pouvoir arbitraire des colons en interposant la loi, c’est-à-dire le roi, entre le maître et l’esclave. Malentendu regrettable ? Pas seulement. La place d’érection de ces statues peut avoir un caractère fortement symbolique : Colbert devant l’Assemblée nationale, comme Christophe Colomb devant le Capitole, semblent rappeler que le sort politique des Noirs a toujours appartenu à des Blancs.
Pour autant, ces statues constituent-elles, comme certains l’ont proclamé, un hommage à la colonisation ? Pour répondre à cette question délicate, il faut lire les inscriptions, interpréter leur vocabulaire (il est vrai que les termes « pacifier », « reconnaissance » peuvent sembler cruellement ironiques), décrypter les bas-relief ou le symbolisme des statues — la taille respective des personnages, leur habit ou leur nudité… Une simple inscription, Ense et aratro (par le glaive et la charrue), sur le socle de la statue de Bugeaud, résonne étrangement quand on se souvient des menaces proférées par le fougueux général de brûler les villages et les moissons des indigènes.
Pour tenter d’avoir un jugement éclairé sur ces pratiques, il faut d’abord rétablir certaines vérités, sans prendre parti ni distribuer des bonnes ou des mauvaises notes. On ne peut laisser dire que les statues parisiennes ne représentent que des hommes blancs dont la majorité est dédiée à des militaires conquérants et coloniaux. Il faut commencer par un pointage, qui montre que sur environ 300 statues de la capitale, 35 se rapportent à 33 militaires, la plupart célébrant des écrivains, des artistes, des hommes politiques, des savants… Il faut aussi une réflexion sur l’espace public, qui dessine un « espace mental » différent des musées ou des collections privées. Au terme de son analyse, Jacqueline Lalouette conclut qu’en France, des monuments ont bien été inaugurés « en hommage à des hommes blâmables sous l’angle de l’histoire de l’esclavage et de la colonisation », mais qu’« aucun ne l’a été à la gloire de l’esclavage et de la colonisation »
Le recensement de ces déboulonnages et une juste remise en perspective ne suffisent pas. Il est urgent d’ouvrir un débat apaisé autour des œuvres réellement problématiques. Faut-il les détruire ? Ce serait effacer l’histoire et donc perdre la mémoire des exactions commises. Les remplacer par des statues d’hommes progressistes (l’abbé Grégoire, le chevalier de Jaucourt…) ou de victimes de la colonisation ? Outre le fait que cela ne fait que déplacer le problème (que faire des statues déboulonnées ?), cela soulève la question des limites entre « bonnes » et « mauvaises » statues — où placera-t-on Voltaire, qui combattit le racisme mais souscrivit à des emprunts de la Compagnie des Indes, qui pratiquait la traite ? Une plaque explicative ? Ce serait pédagogique… si elle avait une chance d’être lue. Ériger à leurs côtés un « contre-monument » ? Cela peut séduire — Bansky a ainsi suggéré d’élever, à côté de la statue de Colston (philanthrope mais négrier), « des statues en bronze grandeur nature de manifestants en train de tirer ». Mais c’est risquer d’entériner la scission entre des mémoires contradictoires — déjà un mouvement White Lives Matter s’en prend à des statues de Noirs — et donc d’attiser plus encore les colères. Alors, les ranger dans des musées ? La signification de ces espaces dédiés serait hélas ambiguë. Ne serait-ce pas un hommage supplémentaire qui risquerait de focaliser un culte de mauvais aloi ? La proposition d’un artiste américain de créer un « parc éducatif » avec toutes les statues vandalisées est dangereusement concomitante avec celle de Donald Trump d’un « jardin national des héros américains ».
On conclut de ce tour d’horizon qu’il n’y a pas de bonne solution à ce problème… et donc qu’il ne peut avoir qu’une dimension politique. Jacqueline Lalouette pointe ainsi les contradictions de Françoise Vergès, militante décoloniale partisane de statues dédiées à des figures historiques de la résistance et du combat pour la liberté, mais qui, lorsqu’Emmanuel Macron invite à une réflexion collective sur ce sujet, y voit une « solution néolibérale qui serait de mettre quelques statues d’Aimé Césaire et de Léopold Sédar Senghor ici et là, un peu comme dans un supermarché on rajoute des aliments de la cuisine “orientale”. » À Bordeaux, une commission de ce type lancée par Alain Juppé en 2016 fit l’objet de critiques de la part de ceux qui n’y avaient pas été conviés. Mais il ne faudrait pas, ici non plus, conclure trop hâtivement à l’hypocrisie ou à la mauvaise foi. Une des motivations de cette guerre des statues est de donner de la visibilité à des groupes « invisibilisés » depuis des siècles. Une solution portée par le pouvoir en place donnera du coup l’impression d’une récupération qui rejettera dans l’ombre ceux qui essayaient d’en sortir. Le grand mérite de ce livre est d’avoir fait le tour du problème sans parti pris et d’avoir analysés les difficultés sans prétendre y apporter une réponse unique et définitive.
Retour au sommaire
Adeline Dieudonné, Kérozène, L’iconoclaste, 2021.

Une station-service sur une autoroute, quelque part en Ardenne, un soir de canicule. Il est 23h 12 au début du roman, 23h14 à la fin. En deux minutes, un drame se joue, se noue et se dénoue, qu’on ne peut comprendre qu’en 250 pages. Quinze personnages s’y sont retrouvés par le hasard de leur propre histoire, « si on compte le cheval et le cadavre ». Un couple accompagne sa grand-mère vers une maison de retraite ; une domestique philippine attend ses patrons ; une jeune femme frustrée tente sa chance avec un garçon timide après avoir été déçue par son mari et par un dragueur invétéré sur une aire de repos ; la rescapée d’un massacre tente de renouer avec la vie…
Chaque chapitre développe, comme dans de courtes nouvelles, tous ces destins brisés qui ignorent l’étrange rendez-vous auquel ils ont été conviés. Tous sont différents, même si certains se croisent. Mais ils ont en commun un accident de la vie, qu’il s’agisse de l’irruption brutale du drame ou d’une lente usure du quotidien dont on prend soudain conscience. Le viol d’une adolescente, la persécution d’un enfant, l’accident d’un tournage publicitaire sont des ruptures nettes ; la phobie d’un monde aseptisé, le long esclavage de la Philippine, les déconvenues conjugales sont de lents supplices. Mais jusqu’aux plus odieux, tous ces personnages sont éminemment humains, donc à plaindre, car ils conservent un espoir, accessible ou chimérique, mais fatalement déçu.
La structure du roman par nouvelles, qui donne rendez-vous à ses personnages dans une scène finale, est sans doute classique, mais elle est utilisée ici avec intelligence et brio.
D’abord, parce que de discrets leitmotive maintiennent une unité d’inspiration. Les boissons, par exemple, jouent un rôle déterminant — le capuccino double crème, le lait, la bière… Mais aussi les animaux, dont la présence était déjà significative dans La vraie vie, le premier roman d’Adeline Dieudonné : ici, outre le cheval qui a droit à son chapitre à la première personne, un dauphin, une truie, un loup, un chien, une mouche, et même des acariens tiennent une place prépondérante. Sans parler des relations de couples, qui forment une trame commune à la plupart de ces récits : les hommes n’y sont pas épargnés, violeurs ou trop plaintifs, dragueurs sans scrupules ou impuissants, maniaques ou franchement psychotiques, gigolos ou éjaculateurs précoces… Face au mâle, la femme n’a pas d’existence propre, qu’elle soit réduite à un objet qu’on abandonne sur un banc, au vagin idéal pour porter un enfant, ou à un sexe de passage. Quant aux enfants, ils servent souvent de souffre-douleur.
Ensuite, et surtout, parce qu’Adeline Dieudonné évite de prendre ses lecteurs pour des imbéciles, ce qui devient rare dans la littérature actuelle. Les récits, qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres, ne prennent sens que par des indices qui peuvent passer inaperçus dans la profusion des détails et l’élégance de l’écriture. Le lecteur doit être attentif s’il veut éviter les pièges d’une lecture rapide : une aire de repos n’est pas une station-service, même si l’on y croise les mêmes personnages ; l’histoire de Julia permet seule de comprendre pourquoi Olivier a dû s’arrêter à la station-service ; il faut noter que le dauphin Reiko a été isolé des femelles pour comprendre l’accident de Victoire ; quant au nœud du roman, il ne tient qu’à une lettre, la marque du pluriel de « cadavres »… Si l’on s’agace de ce qui semble une incohérence, il n’y a qu’à relire : on est passé à côté d’un détail essentiel. Et cela fait vraiment du bien de le découvrir !
Enfin, parce que la romancière sait varier les tons, et quelquefois les mélanger subtilement. Certaines scènes sont d’un comique irrésistible — le combat des ouïk ouïk et des fuuut ne peut laisser personne indifférent, pas plus que la visite à un couple de vieux gynécologues. Pourtant, on glisse vite de l’humour à la détresse. D’autre passages sont d’une poésie fascinante (la danse des âmes convoquées par la fumée d’un joint), d’un souffle véritablement épique (le vortex d’yeux révélés dans les rideaux ou le pacte avec le lac), ou d’une barbarie inexplicable (le massacre gratuit de tout un village). L’histoire est à la fois plus resserrée que celle de La vraie vie, mais aussi plus éclatée, aucun personnage central ne se détachant avant la dernière page. Il manque peut-être l’enjeu dramatique qui, dans le premier roman de l’autrice, servait de fil rouge (la narratrice voulait rendre le sourire à son petit frère). Mais on retrouve ici la somptueuse imagination et le sens de la formule qui avaient fait le succès du précédent livre, avec une écriture plus assurée qui ne se laisse plus prendre à sa facilité. Et Monica, réfugiée comme une sorcière débonnaire au fond de son bois, est un clin d’œil discret au premier roman d’Adelinde Dieudonné... Une indéniable réussite.
Voir aussi : La vraie vie.
Retour au sommaire
Gilles Verdet, Nom de noms, L’arbre vengeur, 2021.

« Les hasards de l’anthroponymie sont impénétrables. Souvent cocasses et quelquefois farceurs. » Nous nous sommes tous amusés avec les noms propres, réels ou fictifs, appropriés à leurs détenteurs ou contrastant avec leur personnalité… Qu’un comédien s’appelle Durideau fait sourire. C’est un « aptonyme, comme on dit dans les revues ». En général, on ne va pas plus loin, sinon à s’étonner de la cruauté de certains parents, d’un Lange qui a prénommé son fils Michel — j’avais un voisin Detaille que son père avait cru spirituel d’appeler Pierre.
Mais les histoires de noms imaginées par Gilles Verdet vont bien plus loin que ces amusements. Le nom détermine la première impression que l’on a d’un individu. Il se voit comme le nez au milieu du visage… Ce n’est donc pas un hasard si l’argot utilise le même terme, « blase », pour désigner le nez et le nom. Et ce n’est pas un hasard si le roman s’ouvre sur la rencontre de M. Rien, qui veut changer de patronyme, et de Mme Personne, qui a fait remodeler son nez. Avec autant de compassion que d’humour, ces nouvelles mettent en scène l’influence des noms sur la personnalité de ceux qui les portent, les difficultés qu’ils rencontrent dans la vie (peut-on faire confiance à un vendeur qui s’appelle Rien ?), les jeux de mots qu’ils subissent (« Personne en saura rien », s’entend-il répondre quand il demande les coordonnées de Mme Personne)… Y a-t-il un destin des noms ? Gérard Souffleur est bien devenu souffleur au théâtre, mais se demande s’il ne devrait pas devenir maraîcher, lorsqu’il découvre que son grand-père avait fait modifier son nom de… Choufleur.
Bien sûr, on s’amusera des jeux de mots et des clins d’œil que multiplie l’auteur à l’envi. Monsieur Rien est « parti de rien », mais dès qu’il est devenu Monsieur Bien, « tout va bien ». On sourira des prénoms qui prolongent le supplice des protagonistes — Claire Matin, Fleur Jardin, les sœurs Aimée et Désirée Personne… Certains se révoltent, d’autres acceptent leur destin farfelu avec résignation ou humour. Certains en jouent malicieusement. Cela crée des situations inattendues, lorsque les personnages se rencontrent. « C’est le télescopage qui crée les histoires de chacun », confie l’auteur, « les croisements impromptus qui engendrent les destins et les rencontres improbables qui les modifient ». M. Lange ne pouvait prendre pour maîtresse qu’une Mme Lediable, et M. Rien, les deux sœurs Personne…
Mais le roman est bien plus qu’amusant. Il est jubilatoire. Cela tient d’abord à la structure romanesque. Les histoires s’embrouillent, s’entremêlent à loisir. Pour payer un maître chanteur, Aimée et Désirée Personne font casquer Fleur Jardin, qui rackette Claire Matin, qui s’en prend à Gérard Souffleur… Les nouvelles se répondent, rebondissent, se bousculent, se nouent et se renouent dans un étourdissant chassé-croisé. Qui finit, d’ailleurs, par percuter le précédent roman de Gilles Verdet. Le lecteur est entraîné dans un hallucinant « roman de nouvelles » qui s’achève sur une double pirouette et boucle sa trajectoire d’un mot qui dit tout… et ne dit rien. Ne gâchons pas le plaisir du lecteur. Car il y a plaisir à se perdre dans un labyrinthe narratif magistralement élaboré. On connaît Gilles Verdet pour sa parfaite technique narrative, qui lui permet d’embrouiller à plaisir les situations dramatiques avant de les démêler d’un coup de baguette magique. Ici, il se surpasse !
Au-delà de cette structure virtuose, on trouvera aussi, au gré des situations, des réflexions plus ou moins amères sur le conformisme et la dictature des normes, sur le sort des migrants, sur la réalité et la fiction… Le roman est loin d’être une coquille vide : la structure est au service d’une réflexion juste sans jamais être pesante ; l’écriture y est soignée et malicieuse. On y découvrira une somptueuse parodie de la scène du balcon, dans Cyrano de Bergerac, qui enseignera le fou rire aux plus grincheux. On s’amusera en passant de raccourcis vigoureux — « C’est dégueulasse comme l’âme humaine » — ou de jeux de langage peut-être gratuits, mais qui reflètent l’état mental du personnage — « J’ai quitté le grand Centre du moyen commerce à petits pas contents. Descendu les étages de galeries avec le cœur montant du travail bien fait. » Et l’on jouira du troublant plaisir de noyer le diable dans le Léthé… À découvrir de toute urgence.
Voir aussi : La sieste des hippocampes, Voici le temps des assassins, Fausses routes, Les Ardomphes. Les passagers. L'arrangement. African Queens.
Retour au sommaire
Yves Namur, Dis-moi quelque chose, Arfuyen, 2021.
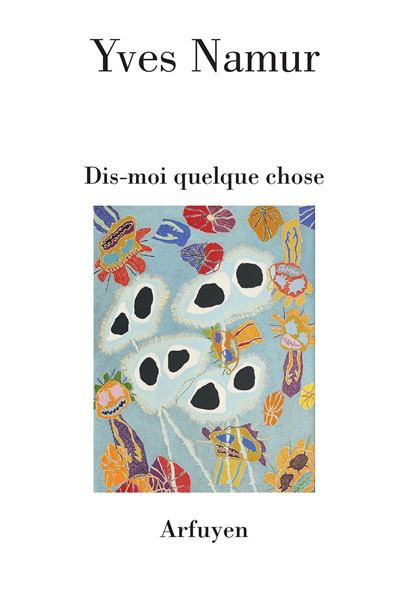
Les mots que l’on attend sont souvent plus urgents que ceux que l’on dit. Ces cent quinze textes sont autant de « prières adressées à l’inconnu, au lecteur éventuel et probablement à moi-même », confie Yves Namur. La similitude des premiers vers, « Dis-moi quelque chose », ainsi que la structure métrique récurrente (des sixains de deux, trois et un vers), la répartition en quatre saisons (qui commencent à l’automne et finissent à l’été) en font une longue litanie conjuratoire, qui invite à dresser la parole contre la morosité, la laideur ou la violence du monde.
La construction de ces sixains, quoique identique, reste souple. Il s’y dessine des mouvements parfois opposés, de l’abattement au sursaut ou de l’exaltation au découragement, dans une lecture verticale qui pose un thème en deux vers, lui donne sa résonance en trois vers, le conclut ou le contredit en un vers.
Parfois, les mots les plus forts, les plus chargés d’énergie, se retrouvent dans les deux premiers vers, comme au sommet de la construction poétique. On remonte du puits, on entrevoit l’insoupçonné, on ouvre, on réveille, on espère… Ce sont d’ailleurs les vers de l’obstination (par la répétition du même incipit) et de la confiance en l’autre (par la deuxième personne du singulier) : « Dis-moi quelque chose »… Le poème se construit alors dans une sorte d’amertume, le vers final, isolé, évoquant les profondeurs, la chute, la vie insoutenable. Mais à d’autres moments, ce sont des mots durs qui ouvrent le sixain : l’abîme, les ruines, l’ignorance… et le poème adopte alors le mouvement inverse d’une remontée vers la lumière, la vie, l’envie. Qu’importe d’ailleurs le sens que l’on donne à la lecture ? L’essentiel est le mouvement que la phrase imprime en nous. L’essentiel est de « rallumer les lampes pauvres », « d’attiser un grand feu », de faire danser la vie avec la folie, autour du feu…
Certains de ces textes laissent une impression de profonde amertume, sinon de détresse ; d’autres nous parlent d’amour, de germination, de soif de vivre. Et d’autres (sont-ils les plus nombreux ou les plus marquants ?) m’ont parlé de la sérénité des retours de longs voyages, du nécessaire effacement de ce qui fut vécu, de ce qu’il faut « ignorer une fois pour toutes », lorsqu’il est plus sage de « ne rien savoir ou presque », et, peut-être, d’effacer demain. Mélancolie ? Peut-être, mais celle de l’apaisement final lorsque l’on a trop regardé, trop entendu, et que l’on s’aperçoit qu’il y a « trop de tout en fin de compte ».
Cette lecture, ou ce voyage intérieur, en dit sans doute plus sur moi que sur Yves Namur, mais n’est-ce pas cela, après tout, la poésie ?
« Dis-moi quelque chose
Comme un grand besoin de larmes
Quand la mer se retire
Quand les forêts se dépeuplent
Quand nos certitudes n’ont plus d’ailes
Ni rien à espérer »
Voir aussi : La tristesse du figuier. N'être que ça. La nuit amère.
Retour au sommaire
Hubert Haddad, La Sirène d’Isé, Zulma, 2021.
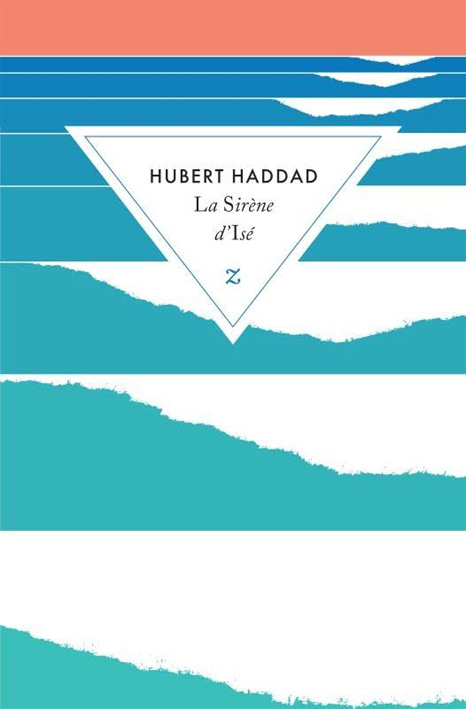
Certains romans sont centrés sur des lieux plus encore que sur des personnages. Le hasard des parutions fait paraître au même moment un roman de Georges-Olivier Châteaureynaud et un roman d’Hubert Haddad qui m’évoquent la même remarque. Un lieu à l’abandon, vestige d’une gloire passée, aux confins du monde, et de nature labyrinthique. Le rapprochement s’arrête là. Les deux romanciers, qui ont tous deux participé à la Nouvelle Fiction, ont leur ton et leur écriture propres, immédiatement reconnaissables. Le labyrinthe d’Hubert Haddad est végétal, élevé sur la pointe sud de la baie d’Umwelt, à l’arrière d’un « drôle de château face au vide ». Le bâtiment, un sanatorium du XIXe siècle, se double ainsi d’une « forteresse arbustive », plantée comme « un défi d’espèce sauvage » dans un fortin de pierre conquis sur la lande.
Le terme Umwelt, emprunté au comportementalisme, renvoie à la perception de l’environnement que chacun, animaux ou humains, peut avoir de son environnement selon les sens qu’il possède. Et c’est bien de cela qu’il s’agit dans cet étrange « création dédalique » conçue par le médecin du sanatorium selon des règles de géométrie fractale : le labyrinthe fonctionne comme un dispositif d’analyse comportementale qui peut provoquer un « collapsus émotionnel » lorsqu’on y interroge ses propres égarements. Il met celui qui s’y aventure en situation de proie, comme s’il était piégé dans une toile d’araignée non gluante. L’angoisse qu’il suscite, liée « à l’épouvante de la dévoration mandibulaire », déclencherait alors une sorte de violence évacuatrice supposée thérapeutique… à condition qu’il puisse en ressortir.
Car ce lieu improbable répond également à une conception musicale, comme une matérialisation du « cercle des quintes », une projection de l’accord de septième diminuée… Une partition a servi de plan, et l’on n’en trouve la sortie qu’en déchiffrant les accords de la basse continue représentés par les haies. Son gardien est un jeune jardinier sourd, Malgorne, fils de Leeloo, une jeune femme internée d’une beauté folle que le médecin avait décidé de garder pour lui. Et c’est là que l’Umwelt prend toute sa signification. Seul un jeune homme sourd peut échapper au piège du labyrinthe musical, comme Ulysse, après s’être bouché les oreilles, échappe au chant des sirènes. Sa perception du labyrinthe passe par d’autres sens, qui lui permettent, notamment, de le retrouver dans la configuration du ciel déchiré par un éclair.
Mais les pièges ne s’arrêtent pas là. Dans ce pays échoué au bord des flots, les sirènes ont d’autres apparences. Peirdre, la jeune fille du phare, et son amie Miranela, n’en sont-elles pas une réincarnation symbolique ? Précisément, Peirdre et Malgorne se rencontrent devant le corps d’un animal étrange échoué sur la plage, un monstre que l’on identifie à une « rhytine », croisement de sirène et de cachalot… Et à l’horizon passe lentement le cargo énigmatique, dont la… sirène est déclenchée par le capitaine Owen, père de Peirdre. Toutes ces thématiques se tissent entre elles autour d’un fil rouge, la perte et la rédemption. « Une fille peut-elle sauver son père du mauvais esprit de l’océan ? » Sans doute comme on sort du labyrinthe… Mais peut-être, aussi, n’arrivera-t-elle qu’à se perdre avec lui.
Ces lieux et ces personnages véhiculent en effet le même sentiment de défaite, d’abandon, de lassitude. Le domaine sinistré, la route côtière menacée d’effondrement, le monstre échoué, le capitaine atteint d’une « forme de mélancolie butée », Malgorne lui-même qui sent que « quelque chose de vital lui échappe, comme le sang des veines »… Tout cela concourt à créer cette atmosphère morose, mais habitée du même espoir ténu. Celui de perpétuer un monde oublié aux valeurs désuètes, mais qui ne veut pas se laisser pas abattre. « On enfermerait aujourd’hui tous les génies de l’air et du feu, les héros et les dieux, la nature entière ! »
Cette envoûtante et tragique histoire d’amour inabouti est servie par la langue somptueuse d’Hubert Haddad, aux métaphores parlantes, surtout lorsqu’il s’agit de traduire les mille nuances de la douleur : « On s’est penché sur elle avec des sourires en ciseaux » — « l’homme à la bonté déchirée » — « il y bredouille une langue de silence » — « la lumière soudain est comme une main tranchée »…
Voir aussi : Le camp du bandit mauresque, Petite suite cherbourgeoise, La culture de l'hystérie n'est pas une spécialité horticole, Le nouveau nouveau magasin d’écriture, Oholiba des songes, Palestine, Géométrie d'un rêve, Vent printanier, Opium Poppy, Sonetti di dolore, Le peintre d'éventail, Premières neiges sur Pondichéry, Mâ, Casting sauvage. Un monstre et un chaos. L'invention du diable, La symphonie atlantique.
Retour au sommaire
Muriel Augry, Encres lacérées, encres de Philippe Bouret, Iasi, Cronedit, 2020
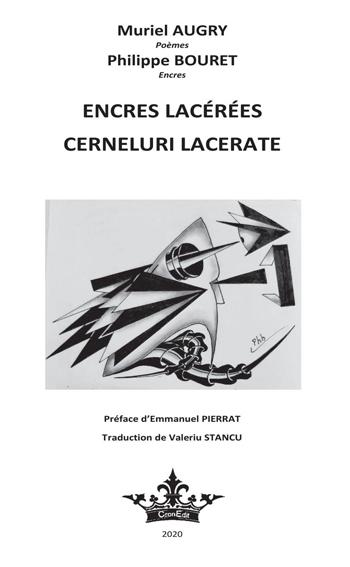
« Elles étaient » / « Elles seront » : deux volets d’un seul diptyque, à la fois poétique et visuel. Mais quand la poésie se voit, quand les encres parlent, la distinction entre les deux arts n’a plus de raison d’être. Ce sont des images qui nous sautent au visage dans les mots de Muriel Augry. Des guerrières en armure, lance au poing, taillant les jours, à califourchon, à l’assaut des désirs vrombissants. Y répondent des compositions abstraites de Philippes Bouret, discrètement sous-titrées « efemmérides » ou « éfemméros »… Des emboitages de formes, d’aspect métallique, aux griffes pointues, acérées, empreints d’une énergie conquérante. Éphémérides ? Oui, si les encres font écho aux « éphémères victoires » de Muriel Augry. Mais femmes, surtout, dans un entrelacement à la fois sensuel et menaçant de tentacules télescopiques. Les encres composent un écho lointain aux textes. Le lecteur y verra, s’il le souhaite, les « chevilles gantées dans des goussets de plomb », des « plumes acérées », le « jour taillé » ou « l’audace au poing » transperçant le bouclier de l’Académie et de la Maison de la Poésie… Mais il pourra aussi, s’il le préfère, projeter sur les textes les suggestions des encres, « l’éfemméride à la méduse » nuancera alors le carcan de l’identité, « l’éfemméride au double » donnera un autre sens aux parchemins portés dans le dos. Telle est la magie de ce mariage des encres.
Le second volet — « Elles seront » — renonce aux termes violents, aux suggestions guerrières, et recourt à un vocabulaire plus sensuel, l’éventail des passions posé au creux des reins, la flûte aux lèvres, l’archet à la main.
Femmes de chair embrasées
Elles iront
tandis que les encres, sans renoncer aux jaillissements télescopiques ni aux fils barbelés, y mêlent des courbes plus douces, seins et fesses ; les éfemméros succèdent alors aux éfemmérides pour se conclure dans une « extase » au sexe grand offert à la page. Appel à la complicité du lecteur, ce petit livre suscitera sans doute bien d’autres lectures, mais il ne pourra laisser indifférent.
Retour au sommaire
Voir aussi : Philippe Bouret, Cet enfant sans mot qui te commence, Ligne de fond.Le spectre du théâtre.
Werner Lambersy, L’Agendada, Saison 3 : Amours, montage et illustrations Yves Barré, ficelle n° 144, janvier 2021.
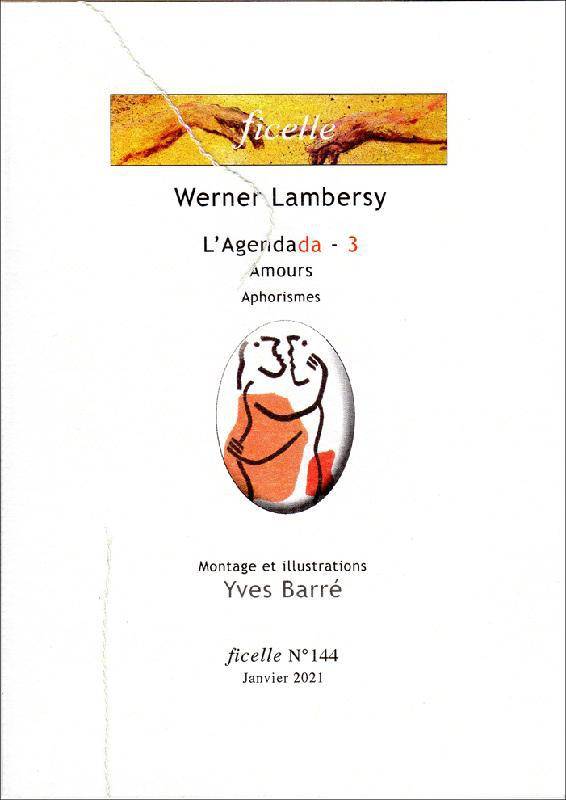
Mais les aphorismes laissent plus de place à l’humour, aux jeux de mots (sacré cœur de Montmartre et sacré cul de Pigalle), aux formules percutantes (« je filme sans pellicule », dit le vieux soupirant), aux images flamboyantes (« Érection matinale, ou le lancer des couleurs sur un bateau pirate »). L’humour cependant reste dans les mots et souvent le ton est grave, mélancolique ou amer, en particulier lorsque la brutalité masculine s’en prend aux « profondeurs féminines », car « Il faut bien l’admettre : le pénis manque singulièrement d’humour ». Alors, même si ces aphorismes se veulent sans prétention, on les dégustera avec la gourmandise d’une complicité de gamins devant la boîte de chocolats. Car ils invitent à réinventer en permanence ce qui ne se conçoit que dans la fulgurance de l’instant, l’amour, la poésie, la beauté. « “Je t’aime” devrait rester un néologisme ».
Retour au sommaire
Voir aussi : Parfum d'Apocalypse, Journal par-dessus bord, Cupra Marittima, À l'ombre du bonsaï, L'assèchement du Zuiderzee, Le mangeur de nèfles, Déluges et autres péripéties, Dernières nouvelles d'Ulysse, La perte du temps, Escaut ! salut, Ball-trap, La chute de la grande roue. Départs de feux, Bureau des solitudes, La déclaration, Du crépuscule des corbeaux au crépuscule des colombes, Al-Andalus, Achille Island, Au pied du vent. Le Grand poème. Ligne de fond. Le jour du chien qui boîte. Table d'écoute, Les convoyeurs attendent, Dormances, Et plus si affinités, Entrées maritimes. Memento du chant des archers Shu. Mes nuits au jour le jour.
Georges-Olivier Châteaureynaud, A cause de l’éternité, Grasset
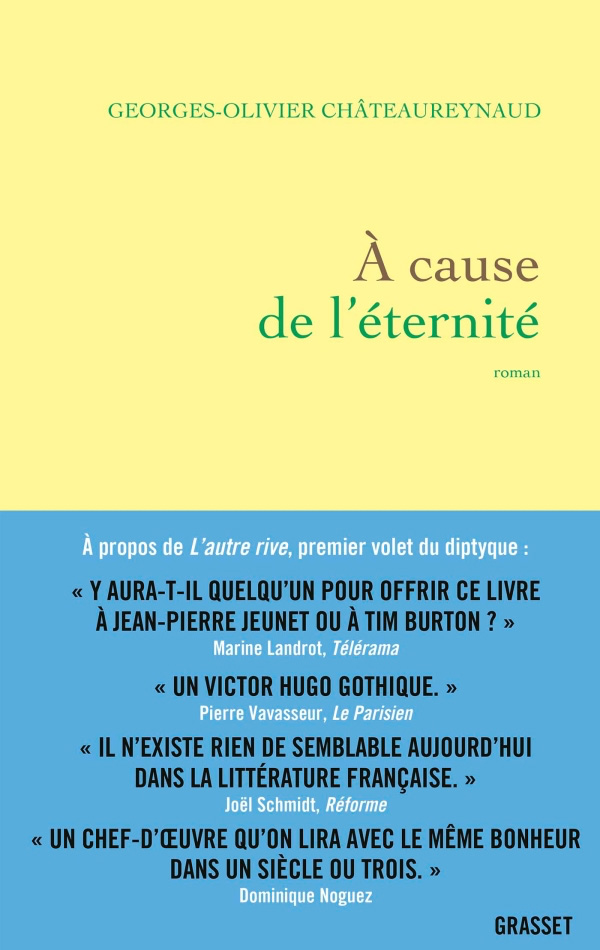
Voilà le roman qu’attendaient tous les exilés d’Écorcheville, cette ville des bords du Styx, « face à l’inconnaissable et dans la proximité des prodiges », dont Georges-Olivier Châteaureynaud avait établi la chronique dans L’autre rive. Tous les exilés d’eux-mêmes et de la vie, « superlativement étrangers » au quotidien, « toujours entre être et non-être, au bord du néant ». Disons-le d’emblée : le défi difficile des « suites » est parfaitement relevé et, si les allusions au premier roman enrichissent la compréhension, sa lecture n’est nullement nécessaire pour goûter pleinement celui-ci. L’intrigue est simple et linéaire. Alphan, après ses études dans un pensionnat suisse, revient à Écorcheville pour se marier. Pris dans un délire de son père, il entre dans un étrange château dont il n’a plus envie de repartir lorsqu’il apprend la mort de sa fiancée. Mais le château lui-même est menacé de tomber dans l’héritage d’un magnat japonais…
On retrouve dans ce deuxième volet l’atmosphère chère à l’auteur, ni réaliste, ni fantastique, mais dans un léger décalage dans la perception de la réalité comme de l’imaginaire. « L’étalon de la réalité n’est pas le même ici qu’ailleurs », remarque un personnage. Tel est le secret de ce récit : l’extraordinaire se mêle au quotidien comme s’il s’agissait de la chose la plus naturelle. On y vit dans la France d’aujourd’hui, avec des téléphones portables, des associations 1901, et l’on paie en euros l’obole à Charon. Les personnages ont face aux excentricités de leur univers les réactions de nos contemporains. Les enfants vont chercher dans la zone interdite des poussées d’adrénaline, les adolescents sont fascinés par les revues pornographiques, les adultes sont en quête d’âmes sœurs et les vieillards, quand ils ont réglé leurs problèmes de retraite, cherchent à fuir les Ehpad. La mise en scène de ces personnages outranciers ou farfelus reproduit notre société occidentale, où le pouvoir se partage entre grandes familles avant que l’élection d’un candidat populiste ne rebatte (provisoirement) les cartes. L’ailleurs n’est pas si loin de l’ici.
Et pourtant, ici, il pleut des insectes ou des crapauds, on repêche des monstres dans le Styx, on les confine au musée de tératologie ou on les protège pour éviter qu’ils ne finissent en attractions touristiques. Ici, il faut se méfier des malfrats, car ils volent… dans les deux sens du terme. Ici, on a « des semelles de plomb mentales », et l’on envie vaguement ceux qui, nés ailleurs, vivent dans « une sorte d’ingénuité confortable ». On rêve de fuir, on fuit, on élève ses enfants dans des pensionnats suisses pour qu’ils épousent de riches héritières anglaises, mais rien à faire : ils reviennent. Parce qu’il y a une collusion secrète entre les hommes et les lieux. La mémoire est « brume et brumasse, brouillard et brouillasse » ; des nuages passent dans les regards ; on tombe comme une pierre tout au fond de soi-même…
Peut-être est-ce par là qu’il faut entrer dans le roman : par les lieux, qui en sont les vrais personnages. Dans L’autre rive, le principal protagoniste était Écorcheville, la ville construite au bord du Styx, sur lequel une société anonyme voulait jeter un pont. Dans ce roman, c’est le château de Thétis d’Éparvay (un clin d’œil significatif à la ville des Ormeaux ou de La faculté des songes). Les lieux clos, déserts, isolés, sont familiers aux lecteurs de Châteaureynaud : îles désertes (Au fond du paradis, Mathieu Chain…), villas ou châteaux abandonnés (La Faculté des songes, Les Ormeaux)… Rassurants comme des refuges contre les vicissitudes de la vie et inquiétants dans leur abandon ou leur délabrement, comme s’ils attendaient sans impatience la fin du monde. Écorcheville et le château d’Éparvay sont des lieux frontières, au bord du monde pour le premier, au bord du temps pour le second. Ils sont à la fois immuables et précaires, figés dans des archaïsmes surprenants (l’esclavage est toujours légal à Écorcheville) et en total déliquescence. La ville d’Écorcheville ne parvient pas à rejoindre le Styx comme le château d’Épervay ne parvient pas à entrer dans l’éternité. Et pourtant, ils y ont déjà posé un pied. L’impression d’abandon est particulièrement forte dans ce roman. Les personnages ont vieilli, pris leur retraite, rejoint l’Ehpad, l’aéroport surdimensionné est vide, la Compagnie du Pont a fait faillite, les villas sont en désordre, les dépôts sont des dépotoirs, le château un capharnaüm délabré… Dans ce « château de la Belle au bois mourant », il faut cacher ses spécificités, les cornes sous une casquette, les sabots dans des bottines — mais comment cacher un Minotaure ou une sphinge ? L’un est à jamais enfermé dans son labyrinthe, l’autre meurt misérablement au musée de tératologie.
On comprend que les personnages soient inquiets, furieux ou démoralisés. Ils ont baissé les bras et vivent dans l’engourdissement infini de leurs rêves ou de leur passé, piégés dans un temps qui s’étire, embourbés dans le temps comme dans les lieux. Ils ont perdu la notion de la durée — depuis combien de temps sont-ils au château ? Nul ne pourrait le dire, et pour cause : en y arrivant, ils ont rejoint une part ignorée d’eux-mêmes.
Les lieux sont des personnages et les personnages, des lieux. La décrépitude du château répond à l’interminable agonie de la duchesse. L’instabilité du temps et des lieux (le château se recompose sans cesse comme une œuvre d’Escher) répond à celle de son plus ancien habitant, surnommé faute de mieux l’Ectoplasme, « coincé dans un présent sempiternel », sur lequel la réalité n’a pas plus de prise que le temps. C’est un des personnages les plus touchants de ce roman, dans son désespoir de ne pouvoir vivre, « à cause de l’éternité », pourrait-on dire, car si sa mémoire absolue lui donne une connaissance parfaite du monde, il n’a rien vécu et se désespère de n’être « pas vraiment un et raisonnablement invariable comme chacun ».
Personnage clé, sans doute, et qui nous introduit dans une autre lecture de l’œuvre : un hommage à la littérature et, au-delà, une plongé dans l’imaginaire. L’Ectoplasme est le lecteur universel, qui « essaie comme des chapeaux toutes les destinées qui lui tombent sous les yeux ». Il est inséparable du conteur, un écrivain réfugié dans le château et qui en rompt la monotonie par des récits qui rebondissent de veillée en veillée dans une sorte de boudoir anglais. Comme jadis Mathieu Chain dans le roman éponyme, Brumaire est un écrivain échoué dans ce château improbable. Son identité cette fois ne fait aucun doute : par son physique, par ses œuvres, il évoque irrésistiblement Georges-Olivier Châteaureynaud. Effacé dans ses premières apparitions, il prend de plus en plus d’importance et, au détour d’une conversation sans sujet véritable, donne quelques clés d’interprétation.
Le monde où vivent ces personnages est d’abord celui des livres, du cinéma, de la fiction. Le jeune Astérion perdu dans son labyrinthe est un hommage à l’Aleph de Borges — le lecteur identifiera çà ou là quelques clins d’œil de ce type ! Si l’on croise au passage des personnages des précédents romans de l’auteur (Mathieu Chain, Lola Balbo…), on traverse au hasard des pérégrinations la place Cornélius Farouk, dédiée à un fantôme ironique de la littérature française… Mais la fiction devient structurante lorsqu’elle conditionne les comportements des personnages — s’il faut choisir une arme pour se défendre, on brandira un browning comme sur les affiches des films policiers. Et le gamin Minotaure enfermé dans son labyrinthe évoque au protagoniste son éducation dans un pensionnat suisse.
Plus largement, c’est l’imaginaire que met en scène ce château, l’imaginaire sans lequel l’homme ne peut vivre et que, souvent, il préfère ignorer, l’imaginaire dans toutes ses composantes : les fictions racontées par Brumaire, bien sûr, mais aussi les mensonges dans lesquels s’enfonce Alphan, ou les rêves, qui semblent avoir autant de réalité que les péripéties de la vie… L’imaginaire dans lequel les personnages trouvent refuge lorsqu’ils ont été blessés par la vie. « Nous constituons un pittoresque club de frileux qui s’efforcent de se tenir chaud », avoue l’un d’eux, on se frotte les uns aux autres pour soigner ses blessures et on se raconte des histoires pour oublier le passé, comme si une vie rêvée pouvait se substituer aux vies meurtries. Le château est la concrétisation spectaculaire de ce réservoir de ce qui pourrait, ou devrait exister. Tout ce qui est possible semble y avoir été remisé, sans inventaire possible (un huissier chargé de le dresser en fait l’amère expérience !), dans des pièces qui se multiplient à l’infini, dans une géographie mouvante, où il suffit souvent de penser à une chose pour se retrouver à l’endroit où elle existe. Selon son humeur, on peut parcourir un couloir en plusieurs heures ou quelques minutes — à la vitesse, en fait, de la pensée, ou de l’imagination. Aussi ne faut-il pas s’étonner qu’il ne soit que la projection des personnages, « hanté d’occupants issus, pour certains, de la mémoire d’Alphan ». Ou, à l’inverse, que les personnages soient la projection de l’univers, n’est-ce pas la même chose ? Les circonstances ont fait d’Alphan un personnage de roman : « Un hasard romancier vous a jeté dans son roman ». À moins qu’il ne soit « captif d’un rêve éveillé de son père ». L’imaginaire inclut ce qui l’inclut : Escher, Escher, quand tu nous tiens…
Si l’on entre dans ce royaume ignoré, il devient impossible d’en sortir, car il finit par nous faire douter de la réalité du monde quotidien, tant il semble plus réel que le réel. « Ailleurs, le monde n’existe pas vraiment, non ? C’est une sorte de… de racontar ! » Alphan, reclus dans le château, finit par considérer le reste du monde comme un théâtre illusoire, « les protagonistes de la comédie du pouvoir au sein d’Écorcheville lui apparaissaient sous l’aspect de marionnettes aux voix criardes, amusant la galerie depuis un castelet dérisoire. » Ce rapport au monde et à l’imaginaire ancre Georges-Olivier Châteaureynaud dans la Nouvelle Fiction, à laquelle il participa dans les années 1990. En fin de compte, l’immersion dans l’imaginaire nous interroge sur le sens de la vie. L’univers dans lequel nous vivons est soumis au hasard. Face au caractère « foncièrement aléatoire de l’existence », les occupants du château découvrent une « nécessité arbitraire » qui se substitue au hasard. Ici, enfin, on peut « se croire missionné, prédestiné, absous quoi qu’il arrive, du moment qu’on a rempli le contrat signé avec soi-même ». Entre hasard et nécessité, tout prend sens.
Cette « nécessité arbitraire », qui panse les plaies du hasard sans nous soumettre à un destin inexorable, délivre les personnage d’une « solitude ontologique », celle d’une existence que l’on ne vit pas vraiment, dont on est trop souvent le spectateur. Tel l’ectoplasme qui ne peut vivre que par le biais de ses lectures, les personnages ont peur de ne pas ressentir pleinement les événements. Au fond, Alphan qui craint de ne pas s’émouvoir comme il le devrait de la mort de sa fiancée, semble incapable d’un lien concret et direct avec ses proches et finit par se demander qui attache une réelle importance à sa présence sur Terre. « Le monde était donc un désert, tout juste peuplé de quelques silhouettes qui pouvaient à tout instant s’évanouir ». Telle est la « solitude ontologique » qui affecte tous les personnages. Les monstres venus d’au-delà du Styx n’ont pas leur place à Écorcheville. Les plus touchants de ces personnages sont en quête désespérée d’amis — l’Ectoplasme incapable de vivre ou Astérion, le Minotaure reclus de peur d’être enfermé dans un musée. Ou dans l’impossibilité de nouer une relation sincère, enfermés dans le secret de leur vie passée, comme le médecin terroriste, ou dans celui d’un ami à protéger, comme Ekatarina qui ne peut révéler l’existence du Minotaure. Au fond, ils sont terriblement humains, ces monstres crachés de l’au-delà, ces hommes échoués aux limites de l’univers, qui se retrouvent à la frontière entre leurs deux mondes.
Mais, surtout, au-delà de l’analyse et des références littéraires, on goûtera ici la somptueuse écriture d’un écrivain qui maîtrise parfaitement toutes les ressources de sa langue, de la notation brève aux phrases sinueuses, des descriptions aux dialogues, de l’évocation d’atmosphères (repas, soirées, averses…) à l’irruption des événements (assassinat, crash, incendie…), avec des formules percutantes, teintées d’ironie ou de morosité. Un gigolo vieillissant n’est plus « qu’un phénix très intermittent », un mélancolique « reprend du poil de la bête de scène », les journaux lus évoquent les reliefs d’un repas — « miettes de mots, épluchures d’articles et phrases rongées comme des os »… Chacun y puisera ses trésors comme les personnages emportent un souvenir privilégié du château détruit de l’imaginaire.
Autres tomes de la trilogie : L'autre rive, Ici-bas.
Voir aussi : Petite suite cherbourgeoise, Singe savant tabassé par deux clowns, L'autre rive, Le corps de l'autre, Résidence dernière, Le goût de l'ombre. Aucun été n'est éternel, De l'autre côté d'Alice, Contre la perte et l'oubli de tout. Nouvelles d'un front. Ce parc dont nous sommes les statues. Ici-bas. Un beau diable.
Retour au sommaire
Françoise Henry, Loin du soleil, éditions du Rocher, 2021.
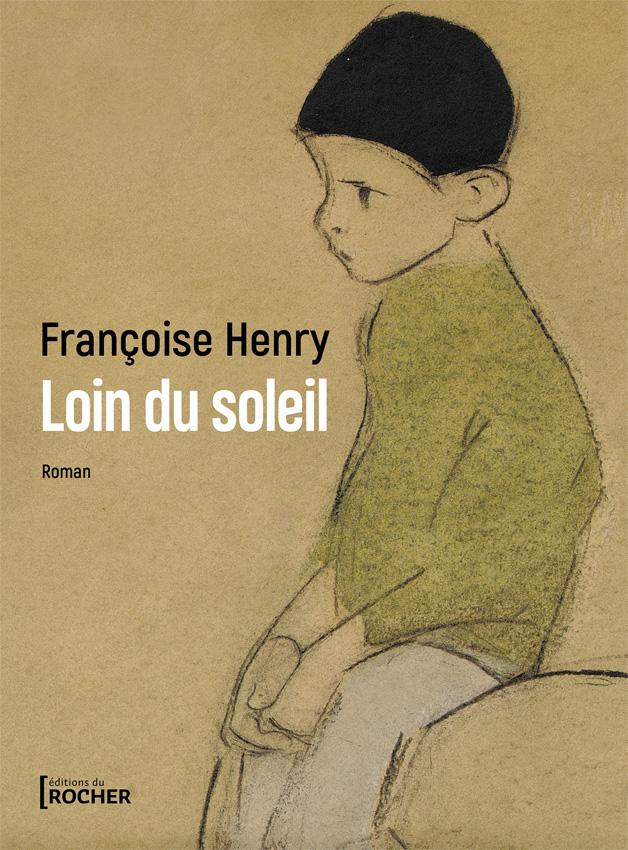
« C’est fou comme on se laisse faire par ce que pense, ou veut, la majorité. » La remarque est glissée, anodine, dans les premières pages. Elle pourrait être une des clés de ce roman tout en pudeur, en signes discrets, en incertitudes. Du principal protagoniste, nous ne connaissons d’abord que ses lunettes rondes, aux grosses montures, pour cacher ses yeux en amande, trop éloignés l’un de l’autre. Rien ne sera dit. À nous de nous demander pourquoi il a été un enfant retardé et pourquoi, à trente ans, il est toujours analphabète. Pourquoi il est si candide, prenant les expressions au pied de la lettre (quand on lui dit que sa mère est au ciel, il imagine qu’elle est partie en avion) et prêt à se laisser dépouiller par son oncle de son héritage.
Loïc est « un cas de mobilité sociale descendante, c’est comme ça qu’on dit, paraît-il ». Le roman, écrit à la deuxième personne du singulier, le suit durant ses trente premières années de revers en revers. Enfant de l’amour, mais orphelin de mère à six ans ; grandissant entre un père alcoolique et une belle-mère qui le dédaigne, il endosse avec résignation le rôle d’idiot du village, « un peu voleur sur les bords, ingérable, ne travaillant pas à l’école, indiscipliné, et ne tenant jamais en place sur ta chaise ». S’il s’enfuit pour se réfugier chez ses grands-parents maternels, c’est pour se trouver persécuté par un oncle qui le considère comme un intrus. Comment pourrait-il se défendre ? « Toi, tu recevais sans broncher ces coups de poing vocaux. » Pour l’entourage, il est disparu soudainement, « comme on efface un nom sur un tableau ». Tout juste parvient-il à se trouver un père d’emprunt, le ramoneur du village qui l’emploie au noir. Au moins gagne-t-il un peu d’argent « à la suie de son front ».
L’alcoolisme du père, l’illettrisme du fils, la violence conjugale, la marâtre mauvaise, l’oncle odieux : on se dit que c’est trop, qu’on noircit le tableau à souhait. Bien sûr, on est « dans la campagne profonde », à l’époque où l’on compte en francs, mais il y a la voisine, aide-soignante pour personnes âgées, habituée peut-on croire à dépister les cas sociaux… C’est alors qu’on se rend compte qu’on est parti sur une fausse piste. Non, on n’est pas dans un roman d’Hector Malot. On s’est laissé entraîner (avec la complicité malicieuse de l’auteur) par ses souvenirs littéraires. La mère de Loïc était surnommée la « Madame Bovary du coin », mais par les « intellectuels estivaux » (au temps pour nous !). Le père, couvreur alcoolique tombant du toit, nous a fait penser à Zola ; la spoliation d’héritage, à Balzac. Mais nous ne sommes ni dans Ursule Mirouët, ni dans l’Assommoir !
Alors on repense à la petite phrase du début… « C’est fou comme on se laisse faire par ce que pense, ou veut, la majorité. » Tel est le sujet du roman : non l’histoire de Loïc (le « tu »), mais celle de sa voisine (le « je), l’observatrice, Greta, qui observe, écoute, mais imagine, aussi, ce dont elle n’a pas eu connaissance. Elle souffre d’une maladie orpheline, une photodermatose de la peau, qui lui interdit toute exposition aux ultraviolets, donc au soleil. C’est elle qui reste « loin du soleil », au sens propre, quand Loïc l’est au sens figuré. Un personnage de l’ombre, à l’opposé de Nadine, la mère de Loïc, qui s’exposait au soleil « à en mourir ». Le parallélisme est manifeste, et significatif. Nadine, la jeune femme solaire, « montée au ciel » en laissant Loïc démuni ; Greta, vouée à la pénombre, qui endossera un rôle maternel, comme « une subrogée fantôme ».
Car Greta elle-même ne peut concevoir sa photodermatose comme une fatalité. « Pourquoi ai-je cette maladie ? Quelle punition, et pour quel crime ? » Devoir se cacher de la lumière : n’est-ce pas plutôt la punition de celle qui n’a pas voulu affronter la réalité ? De petites notations nous mettent la puce à l’oreille. Loïc vole-t-il un billet de dix francs ? « Je ne veux rien savoir de plus. » Son père revient-il d’une cure de désintoxication ? « Je faisais comme si je ne savais pas ». Quant à ce que vit le garçon presque sous ses yeux : « Quand on soupçonne un drame il arrive qu’on fuie, pour ne pas mettre les pieds dedans. » Le roman sera celui de la fuite de Greta, plus que de la disparition de Loïc : ce n’est que dans les dernières pages qu’elle endossera véritablement le rôle qui lui est dévolu.
Et plus largement, c’est le drame de toute la famille, de tout le village. Le père refuse de voir son problème d’alcoolisme et, quand on le lui montre, il se trouve « interdit de déni » ! Les voisins parisiens retournent à la capitale. Les voisins, à leur quotidien. « On a de grands élans comme ça, on a les yeux embués quand on en parle, puis on se retrouve vite coincé dans ses habitudes. » Narré par une femme qui doit fuir la lumière, le roman tout entier est celui de l’aveuglement volontaire.
Voué à un « ensevelissement programmé », Loïc parviendra-t-il à échapper à son destin ? Le roman nous laissera prudemment dans l’incertitude. Deux mouvements opposés y maintiennent la tension. Tantôt, on insiste sur la déchéance du père et le salut du fils. Tantôt, sur le parallélisme entre leurs destins — Loïc se met à boire comme son père, il devient couvreur comme lui… Ce n’est peut-être pas le principal. L’important, c’est que celui qui n’était rien — un « mauvais souvenir » qui « gâcherait la pellicule » — soit devenu quelqu’un. Pour son oncle, un héritier, qui menace son propre héritage (et peu importe, en fin de compte, s’il obtiendra gain de cause ou non). Pour son père, un « compagnon de beuverie » : « C’est une place terrible, mais c’est toujours une place. Même bradée, tu la prends. » Exister, c’est aussi se retrouver un jour dans la lumière, cesser d’être « loin du soleil ».
Voir aussi : Le drapeau de Picasso, Plusieurs mois d'avril, Sans garde-fou, Juste avant l'hiver. Jamais le droit de crier. N'oubliez pas Marcelle.
Retour au sommaire